Bradford Littlejohn a publié en 2021 sur le site American Reformer un article en trois parties dans lequel il explique pourquoi, selon lui, les chrétiens, et en particulier les protestants, devraient accueillir positivement le concept de « nation » et se reconnaître comme des « chrétiens nationalistes ». Cet article, rédigé par un auteur américain, s’adresse principalement à la situation des chrétiens aux États-Unis. Cependant, même si l’auteur ne vise pas directement un lectorat francophone, certaines de ses réflexions dépassent le contexte américain et peuvent intéresser les lecteurs francophones de Par la foi. Après avoir publié en français la première partie de cet article, nous donnons ici la traduction de la deuxième partie, avant de publier la prochaine fois sa troisième partie.
Les fantômes de l’Empire dans l’Europe chrétienne
Dans le célèbre préambule de l’Act in Restraint of Appeals de 1533, par lequel l’Angleterre rejeta le joug de toute soumission à Rome, Thomas Cromwell déclara, au nom de son seigneur le roi Henri VIII, que « diverses histoires et chroniques anciennes authentiques déclarent et expriment clairement que ce royaume d’Angleterre est un empire ». Il y avait là une ironie consciente. Après tout, que pouvait bien signifier parler d’« un empire », avec l’article indéfini ? Tout le monde en Europe savait, après tout, qu’il n’y avait qu’un seul empire, un seul dominus totius mundi, « seigneur du monde entier », et qu’il s’agissait de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. Son seul rival pour cette seigneurie était le Saint-Père, qui avait déclaré qu’« il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d’être soumise au pontife romain. »
Malgré la riche vision biblique de nations indépendantes apportant chacune leur gloire au royaume de Dieu, le chemin vers le nationalisme à l’ère chrétienne n’a pas été sans embûches. En effet, ce n’est qu’avec la Réforme protestante que l’idée féconde d’une nation alliancielle, plantée dans le sol de l’ancien Israël, a commencé à prendre racine et à se développer.
Dans l’Antiquité, les nations étaient relativement rares en tant qu’entités politiques. Les nations nécessitaient un code juridique commun et une administration cohérente de la justice sur un territoire étendu, ce qui était rendu difficile par les modes de transport et de communication primitifs. La plupart des gens vivaient dans de petites cités-états ou dans des confédérations peu structurées de villes voisines, qui étaient constamment en guerre les unes contre les autres et exposées aux ambitions de voisins puissants. Ces voisins établissaient parfois de vastes empires, comme l’Égypte et l’Assyrie, mais ces empires n’étaient pas tant des entités politiques stables que des puissances militaires qui extorquaient par intermittence des tributs et des promesses d’obéissance aux cités-états éloignées qu’elles avaient vaincues au combat. Ce n’est qu’avec l’essor de Rome qu’un empire capable de dominer durablement et de gouverner efficacement un vaste territoire a vu le jour.
Au sein de cet empire, l’Église chrétienne prit forme, proclamant la royauté unique du Christ, et non celle de César. Au commencement, toutefois, cette proclamation n’était pas considérée comme un rejet de l’Empire. Bien au contraire, au cours de leurs siècles de domination, les empereurs romains s’étaient imaginés être les seigneurs de la terre — en grande partie de facto, pour ce qui en restait de jure — chargés par les dieux de faire régner la paix et l’ordre parmi tous les peuples. Lorsque Constantin s’est incliné devant Jésus en tant que Roi des rois, il était naturel pour les dirigeants chrétiens de fusionner la vocation universelle de Rome avec la mission universelle de l’Église chrétienne. Après tout, le règne du Christ était unique et universel, chaque tribu et chaque nation étant appelées à lui rendre hommage en se soumettant à un seul Évangile et à une seule Église. À chaque époque, les chrétiens ont été tentés d’« immanentiser l’eschaton », c’est-à-dire de transposer les attentes du royaume eschatologique de Dieu au cœur de l’histoire. Il en fut ainsi pour les premiers chrétiens, étourdis et ravis par la conversion de Constantin et la fin des persécutions : peut-être la Rome chrétienne allait-elle être la manifestation politique terrestre du royaume mondial du Christ.
Ces rêves furent cruellement anéantis par les vagues de barbares qui déferlèrent sur les frontières d’un Empire romain surmené et exsangue, jusqu’à piller Rome même en 410 après J.-C. Mais les vieux rêves ont la vie dure. Les institutions impériales dépérirent et les empereurs s’enfuirent à Constantinople, mais le fantôme de l’Empire romain continua de hanter les forêts désormais obscures de l’Europe féodale, pour finalement s’installer dans deux institutions émergeant de l’empire chrétien : la papauté et le Saint-Empire romain germanique.
Pendant plusieurs siècles, même si l’idéologie officielle de l’Europe chrétienne restait impériale, la réalité sur le terrain était tribale, avec des centaines de petits royaumes tenus ensemble par des troupes de guerriers dévoués à des chefs charismatiques. Avec le temps, ce tribalisme brut s’est transformé en ce que nous appelons aujourd’hui la féodalité, une structure de liens politiques décentralisés et imbriqués reposant sur des serments de loyauté personnelle et des promesses de protection. Mais comme tous les ordres tribaux, la féodalité restait violente et instable, et le progrès civilisationnel était lent, même si l’unité globale de l’Église chrétienne contribuait à instaurer un certain degré de paix.
Cependant, cette œuvre civilisatrice de l’Église était inextricablement mêlée à une dangereuse hybris. Alors que la Rome païenne avait joyeusement toléré une multitude vertigineuse de cultures, de cultes et de religions à travers son vaste empire, la Rome chrétienne, sous l’autorité du pape dont le pouvoir ne cessait de croître, cherchait à imposer une homogénéisation toujours plus poussée. L’universalité de l’Évangile et la loi divine des Écritures exigeaient, selon elle, une certaine universalité politique lui correspondant. Cela fut visible dès les premières années de l’Église en Angleterre, dont Bède le vénérable a relaté la farouche détermination des prélats formés à Rome à imposer au clergé irlandais, autrefois indépendant, le calendrier et les rituels pratiqués à Rome. Avec le temps, les revendications de Rome s’étendirent de plus en plus à ce qui relève du rituel à ce qui relève de la politique. Les croisades, par exemple, furent conçues par le pape Urbain II comme un moyen permettant à la fois de détourner de leurs conflits les seigneurs féodaux en guerre entre eux et de renforcer sa propre autorité en tant que représentant d’une Europe unie. Les papes qui lui succédèrent et les principaux ecclésiastiques de ce temps commencèrent à s’immiscer plus directement dans les affaires intérieures des royaumes chrétiens. En Angleterre, par exemple, Thomas Becket exigea l’autonomie et l’immunité de tout le clergé vis-à-vis des lois anglaises, et le pape Innocent III revendiqua plus tard la souveraineté sur l’Angleterre et excommunia tout le royaume après un différend avec le roi Jean. Peu de temps après, les papes prêchèrent la croisade non seulement contre les infidèles des pays musulmans, mais aussi contre les royaumes chrétiens qui ne reconnaissaient pas leur suprématie en tant que représentants du règne mondial du Christ.
Dans le même temps, cependant, les premiers signes du nationalisme commencèrent à se faire sentir, surtout en Angleterre. De puissants rois réformateurs tels qu’Henri II (1152-1190) puis Édouard Ier (1272-1307) comprirent l’importance du droit pour leur permettre de souder leur grand royaume insulaire et d’empêcher les barons féodaux de le réduire à la quasi-anarchie qui régnait alors dans une grande partie de l’Europe. En encourageant le développement à Londres d’une profession juridique qualifiée chargée de rendre impartialement la justice tant envers les seigneurs qu’envers les roturiers, ils établirent pour la première fois dans l’Europe post-romaine une common law qui allait progressivement réduire l’autonomie des barons. Parallèlement, en convoquant le Parlement en tant qu’assemblée représentative de la nation tout entière, ils commencèrent à inculquer aux Anglais le sentiment d’appartenir à un projet national commun qui transcendait leurs comtés et leurs provinces. Bien que l’Angleterre retombât un temps dans le féodalisme pendant les guerres dévastatrices des Deux-Roses, les puissants monarques de la maison Tudor reprirent le processus de construction nationale, en renforçant d’abord la Couronne et le Parlement contre les menaces internes des barons féodaux factieux, puis contre l’autorité intrusive du pape.
La Réforme protestante : un mouvement d’indépendance
Bien que nous n’y songions plus guère aujourd’hui, la Réforme fut autant un mouvement d’indépendance nationale qu’un mouvement d’indépendance religieuse. De fait, les deux étaient étroitement liés, car c’est précisément grâce à ses revendications théologiques en tant que vicaire du Christ que le pape revendiquait aussi une domination politique sur toute l’Europe. Un peu comme l’Union européenne moderne, l’Église papale était devenue une bureaucratie transnationale hypertrophiée qui exigeait des tributs, promulguait des lois sans consultation et établissait des tribunaux qui pouvaient passer supplanter la justice locale. Lorsque le pape Léon X exigea que Frédéric le Sage de Saxe lui livrât son moine mécréant, Martin Luther, Frédéric refusa, non pas pour des raisons théologiques (il était lui-même encore un fervent adorateur des saints et collectionneur de reliques), mais pour des raisons de souveraineté : si Luther avait commis une faute, il devait être jugé en Allemagne, et non à Rome.
Luther a donné corps au sentiment nationaliste naissant dans sa lettre À la noblesse chrétienne de la nation allemande, dans laquelle il appelait les princes allemands à cesser de se soumettre aux ordres du pape et à affirmer leur autorité pour réformer leurs propres Églises et lois. Après une longue lutte avec l’empereur Charles Quint, ce principe a été incarné dans la phrase : cuius regio, eius religio : « tel prince, telle religion ». Cette expression récapitulait parfaitement l’accord historique de la paix d’Augsbourg de 1555, qui mit fin au rêve papal d’une Église indivise soumise au siège de saint Pierre. Elle devint le modèle de la vision moderne des Églises nationales et des institutions religieuses nationales dans toute l’Europe. Bien que cela puisse nous sembler être davantage une forme instaurant l’étatisme plutôt que la liberté religieuse, pour les protestants du début de l’ère moderne, c’était une victoire pour l’autodétermination locale ou nationale. Après tout, l’alternative n’était pas la liberté de conscience individuelle, mais plutôt la subordination à la papauté. Soit l’Église papale pouvait déterminer toutes les questions d’orthodoxie et exiger la soumission universelle de chaque conscience chrétienne, soit les différents princes pouvaient être libres de suivre leur propre conscience pour légiférer dans leurs principautés.
La paix d’Augsbourg mit également fin au rêve de l’empereur Charles Quint d’un empire catholique universel. En effet, la lame de fond nationaliste soulevée par la Réforme n’avait que trop tardé. Pendant des siècles, le « Saint-Empire romain germanique » avait été davantage une idée qu’une réalité — ni saint, ni romain, ni empire, comme le dira Voltaire avec ironie. Mais le jeune Charles Quint, couronné à l’âge de dix-neuf ans empereur d’Allemagne, roi d’Espagne et de Naples, duc de Bourgogne et seigneur des Indes, avait l’intention de changer cela. Pour la première fois dans l’histoire, un seul homme pouvait prétendre de manière plausible être « seigneur du monde entier » (du moins si l’on excluait l’Asie pour le moment), et pour Charles, cette seigneurie était indissociable de sa vocation de monarque catholique à établir la seule vraie foi dans tous ses domaines. Bien que ses objectifs aient été contrariés par l’obstination de la résistance protestante, son fils Philippe II d’Espagne reprit rapidement le flambeau, administrant son vaste empire avec un zèle fanatique pour l’orthodoxie catholique, zèle partagé par son épouse, la reine Marie d’Angleterre.
Peu de gens se rendent compte aujourd’hui à quel point l’Angleterre, qui venait de déclarer son indépendance vis-à-vis de la papauté sous Henri VIII, a failli être absorbée non seulement par l’Église catholique, mais aussi par le vaste empire Habsbourg de Charles et de Philippe sous le règne de Marie Tudor (« Marie la Sanglante »). Sa mort prématurée en 1558 a toutefois permis à la reine protestante Élisabeth d’accéder au trône, assurant ainsi que l’Angleterre deviendrait, au cours des deux siècles suivants, non seulement le principal champion du protestantisme en Europe, mais aussi, dans une mesure croissante, du nationalisme. Lorsque le pape Pie V excommunia imprudemment Élisabeth en 1570 et appela les puissances catholiques à envahir son île, il réussit seulement à rallier le sentiment patriotique anglais à sa cause. Et lorsque, en 1588, la puissante Armada espagnole débarqua en Angleterre pour tenter de mettre à exécution la menace contenue dans l’excommunication de Pie V, Élisabeth rallia avec force les sentiments nationaux et religieux de son peuple dans l’un des plus grands affrontements de l’histoire entre David et Goliath.
L’Angleterre : une nation protestante
Au début du XVIIe siècle, une conscience claire de la vocation nationale anglaise s’était donc imposée : les Anglais formaient un peuple certes petit mais indépendant, qui ne revendiquait pas un vaste empire, mais disposait d’une marine puissante capable de se défendre sur les sept mers ; ils étaient fiers de leur Parlement représentatif, de leurs libertés garanties par la Charte et de leurs droits de conscience ; ils étaient protestants, et non catholiques, et viendraient en aide, dès que l’occasion se présenterait, à leurs frères protestants en difficulté sur le continent. Ils se voyaient confrontés à une menace mondiale coordonnée : un pape autoritaire et tyrannique qui régnait en maître sur les rois et les consciences ; des souverains catholiques absolutistes qui bafouaient les libertés garanties par la Charte et les assemblées représentatives ; et une puissante monarchie espagnole qui prétendait avoir hérité de l’hégémonie mondiale de l’Empire romain et de la permission expresse du pape, et qui asseyait ces prétentions sur des montagnes d’or en provenance du Nouveau Monde. Les colonies anglaises en Virginie furent donc conçues dans le cadre de la mission protestante et anti-impérialiste de l’Angleterre : mettre fin aux prétentions exagérées de l’Espagne à la domination du monde et faire refluer la marée des missions catholiques.
Bien que la puissance de l’Espagne se soit effondrée au cours des décennies suivantes, son rôle fut rapidement repris par la France de Louis XIV, le « roi très chrétien », qui se considérait comme un nouveau Charlemagne, chargé de restaurer la pureté de la foi catholique romaine et la gloire de l’ancien Empire romain dans toute l’Europe. Louis aspirait à une « monarchie universelle » sur l’Europe et le Nouveau Monde, et se mit en tête d’étouffer les nations indépendantes émergentes à ses frontières, à commencer par la République protestante des Pays-Bas, qui avait développé une riche culture nationale et des institutions politiques représentatives au cours du siècle qui avait suivi sa libération du joug espagnol. Et lorsque le catholique Jacques II monta sur le trône d’Angleterre en 1685, plus rien ne semblait pouvoir entraver l’impérialisme de Louis. Seule la Glorieuse Révolution de 1688, au cours de laquelle le prince néerlandais Guillaume d’Orange monta sur le trône d’Angleterre et coordonna une alliance paneuropéenne contre la puissance écrasante de la France, rétablit l’équilibre des pouvoirs et ouvrit la voie à l’épanouissement du nationalisme dans toute l’Europe.
Le succès de l’Angleterre en tant que premier état-nation d’Europe et phare de la liberté politique fut tel que les penseurs de toute l’Europe continentale commencèrent à revoir leurs théories politiques, autrefois impérialistes. Le plus éminent d’entre eux fut Montesquieu, qui fustigeait les vaines aspirations de la France à une monarchie universelle, ridiculisait l’Église catholique et louait la constitution libérale de l’Angleterre. Dans son ouvrage L’Esprit des lois, l’œuvre politique la plus influente du XVIIIe siècle, il défendait la bonté intrinsèque de la diversité des nations, insistant sur le fait qu’un bon gouvernement s’adapte à l’esprit de chaque peuple et que toute tentative d’établir une règle uniforme sur des peuples et des cultures différents dégénère en tyrannie. Peu après, un théoricien politique réformé suisse, Emer de Vattel, rédigea son chef-d’œuvre Le droit des gens, dans lequel il exposait une théorie complète de la souveraineté nationale, des obligations découlant des traités et de l’équilibre des pouvoirs, et présentait à nouveau l’Angleterre comme la nation modèle. Critiquant les anciens projets des papes et des empereurs catholiques, Vattel déclara fameusement : « Un peuple ne doit point recevoir la loi, ni souffrir qu’ils se mêlent de ses affaires, qu’ils lui enlèvent ses avantages. »
Un quart de siècle plus tard, les Pères fondateurs américains, découvrant que l’Angleterre protestante libre s’était muée en un empire « papiste », gouverné non plus par les liens de la loyauté mais par la force, se tournèrent vers Montesquieu et Vattel pour appeler l’Amérique à « de prendre, parmi les puissances de la terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit ». Ce faisant, ils ont exprimé une conception de la liberté politique et de l’indépendance nationale enracinée dans une vision profondément biblique et dans l’expérience de la Réforme protestante.
Protestantisme et nationalisme
Quel est donc le rapport entre protestantisme et nationalisme ? Eh bien, même aujourd’hui, la liberté est largement considérée en terme d’autonomie, et la tyrannie en terme d’intouchabilité. Ces préoccupations ont précisément façonné la critique protestante de la papauté et de l’empire. Par la simple étendue géographique de ses revendications, la papauté entravait la liberté des différents royaumes de la chrétienté de diriger chacun leur propre vie nationale ; par la profondeur spirituelle de ses revendications, le pape revendiquait la seigneurie même sur le sanctuaire intérieur de la conscience, ne laissant aucune place où l’individu pouvait se tenir seul devant son Créateur. En revendiquant la suprématie sur toutes les autres autorités ecclésiastiques, lois et conciles, le pape était le plus absolu des souverains, n’ayant de comptes à rendre à aucune autorité humaine. Les protestants protestèrent donc à la fois contre la juridiction universelle et la nature despotique de l’Église romaine. En outre, ils devinrent de plus en plus convaincus que, puisque Rome avait durci ses prétentions, elle avait entraîné les souverains temporels dans la même voie : ils cherchaient tous à régner sur d’autres peuples, corps et âme, et gouvernaient de manière autocratique, sans rendre de comptes et sans se soucier des libertés de leurs sujets.
Face à cet impérialisme religieux ou séculier, les premiers auteurs protestants plaidèrent en faveur d’une distinction claire entre le royaume unique du Christ et les royaumes pluriels de ce monde. Ils cherchèrent à désimmanentiser l’eschaton. S’il n’y avait qu’une seule foi et qu’un seul baptême, cette unité de confession n’impliquait pas pour autant la nécessité d’un ensemble unique de rituels dans chaque Église ou d’un ensemble unique de lois applicable à tous les royaumes ; si Christ était le roi des rois, son empire n’avait pas besoin d’être représentée par un vice-roi terrestre. S’inspirant largement de l’Ancien Testament, les premiers protestants anglais et néerlandais, puis d’autres à travers l’Europe, commencèrent à discerner dans l’expérience de la nation d’Israël un modèle pour leurs propres expériences en tant que nations particulières, constituées de nombreuses tribus organisées face à des ennemis communs et soumises à des lois communes, et qui s’étaient engagées devant Dieu à rechercher la justice et la droiture.
Quelle pertinence a encore aujourd’hui cette vision qui inspira nos ancêtres américains ? L’Amérique, avec son vaste territoire de 330 millions d’habitants et ses responsabilités mondiales peut-elle encore prétendre être une nation plutôt qu’un empire ? Et même si tel est le cas, à quoi pourrait ressembler une réaffirmation des bienfaits du nationalisme dans le contexte actuel de résurgence des tribalismes et des idéologies mondialistes ? Nous aborderons ces questions dans la troisième partie.
Illustration de couverture : C. Hassam, Avenue in the Rain, huile sur toile, 1917 (Washington, Maison Blanche).

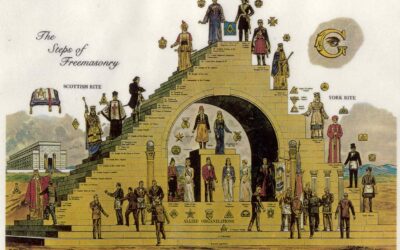



0 commentaires