Grégoire le Grand, évêque de Rome (pape) de 590 à 604, est un des grands pères de l’Église latins. Grand exégète, il a laissé de célèbres commentaires et collections d’homélies sur les Évangiles, sur Job et sur Ézéchiel. L’extrait suivant constitue le prologue de son commentaire sur le Cantique des cantiques, malheureusement fragmentaire (seul le commentaire des huit premiers versets du livre nous est parvenu). Ce texte a également été repris par Richard de Saint-Victor dans son propre commentaire du Cantique. Saint Grégoire y précise sa vision du sens allégorique de l’Écriture.
Nous citons le commentaire dans l’édition de Rodrigue Bélanger dans la collection des Sources chrétiennes, 1984.
Depuis que le genre humain a été expulsé des joies du paradis, entrant dans l’exil de la vie présente, il a le cœur aveugle à l’égard de l’intelligence spirituelle. Si la voix divine disait à ce cœur aveugle : « Marche à la suite de Dieu » ou « Aime Dieu », comme on le lui a dit dans la Loi, désormais exilé, refroidi et engourdi dans l’insensibilité, il ne saisirait pas ce qu’il entendrait. Aussi est-ce par énigmes que le discours divin s’adresse à l’âme engourdie par le froid et que, à partir des réalités qu’elle connaît, il lui inspire secrètement un amour qu’elle ne connaît pas.
L’allégorie offre en effet à l’âme éloignée de Dieu comme une machine qui la fait s’élever vers Dieu. Par le moyen des énigmes, en reconnaissant dans les mots quelque chose qui lui est familier, elle comprend dans le sens des mots ce qui ne lui est pas familier, et grâce à un langage terrestre, elle est séparée de la terre. Car, n’ayant pas d’aversion pour quelque chose de connu, elle comprend quelque chose d’inconnu. C’est en effet de ces réalités qui nous sont connues et dont sont faites les allégories que se revêtent les pensées divines ; alors en reconnaissant l’apparence extérieure des mots, nous parvenons à l’intelligence intérieure.
De là vient en effet que dans ce livre intitulé Cantiques des cantiques (sic) sont employés les termes d’un amour qui paraît charnel : c’est afin que l’âme, sortant de son engourdissement, se réchauffe sous la friction de propos qui lui soient familiers et, grâce au langage de l’amour d’ici-bas, soit stimulée à l’amour d’en-haut. Dans ce livre en effet, on prononce le nom des baisers, le nom des seins, le nom des joues, le nom des cuisses ; ces mots ne doivent pas provoquer la moquerie vis-à-vis du texte sacré, mais faire estimer pour plus grande encore la miséricorde de Dieu : car, lorsqu’il mentionne les parties du corps et convie ainsi à l’amour, il faut remarquer de quelle façon merveilleuse et miséricordieuse il agit envers nous, lui qui, pour enflammer notre cœur et le provoquer à l’amour sacré, va jusqu’à employer le langage de notre amour grossier. Pourtant, par le fait même qu’il s’abaisse en parole, il nous élève en compréhension : car, c’est à partir du langage de cet amour-là que nous apprenons avec quelle force nous devons brûler de l’amour divin.
Par ailleurs, il nous faut faire soigneusement attention à ce qu’à l’écoute du langage de l’amour extérieur, nous n’en restions aux sensations extérieures, et que la machine mise en place pour nous élever ne nous écrase plutôt, au point qu’il nous soit impossible de nous élever. Nous devons en effet, à travers ce langage corporel, à travers ce langage extérieur, rechercher tout ce qui est intérieur et, tout en parlant du corps, devenir en quelque sorte extérieurs au corps. Nous devons venir à ces saintes épousailles de l’Époux et de l’Épouse avec l’intelligence de la charité la plus intérieure, autrement dit, y venir avec la robe nuptiale. Cela est nécessaire : si nous ne revêtons la robe nuptiale — entendons une juste intelligence de la charité —, nous serons expulsés de ce repas nuptial dans les ténèbres extérieures, c’est-à-dire dans l’aveuglement de l’ignorance1. Nous devons, à travers ce langage de la passion, en venir à la vertu d’impassibilité. Il en est en effet de l’Écriture sainte par rapport aux mots et aux significations comme de la peinture par rapport aux couleurs et aux objets ; et bien sot qui s’arrête aux couleurs de la peinture au point de ne pas reconnaître les objets qui sont peints ! Nous de même, si nous ne saisissons les mots que dans leur usage extérieur et restons ignorants de leurs significations, c’est comme si, ignorant les objets qui sont peints, nous ne nous attachions qu’aux couleurs. « La lettre tue, est-il écrit, mais l’esprit vivifie2. » En effet, la lettre recouvre l’esprit de la même façon que la paille enveloppe le froment. Mais c’est le propre des bestiaux de se repaître de paille, celui des hommes de se nourrir de froment. Ainsi, que celui qui est doté de la raison humaine rejette la paille des bestiaux et se hâte de manger le froment de l’esprit. Il est en effet utile que les mystères revêtent les enveloppes de la lettre pour que la sagesse recherchée ait plus de saveur. Voilà pourquoi il est écrit : « Les sages dissimulent l’intelligence3 », précisément parce que l’intelligence spirituelle est couverte de l’enveloppe de la lettre. Voilà pourquoi il est dit encore dans le même livre : « C’est la gloire de Dieu de dissimuler sa parole4. » C’est un fait que Dieu se manifeste avec d’autant plus de gloire à l’âme de qui le cherche que sa manifestation est recherchée avec plus de perspicacité et d’intériorité. Mais est-ce que, par hasard, ce que Dieu dissimule dans ses mystères, nous ne devons pas le rechercher ? Nous le devons assurément d’après ce qui suit : « Et c’est la gloire des rois de scruter la parole4. » Ils sont rois en effet, ceux qui ont déjà appris à régir et à scruter leur corps et les mouvements de la chair. C’est donc la gloire des rois de scruter la parole, parce que c’est l’honneur de ceux qui vivent dans le bien de percer les secrets des commandements de Dieu. En entendant donc le langage du commerce des hommes, nous devons pour ainsi dire nous trouver à part des hommes ; sans quoi, nous ne pourrons rien ressentir du sens divin de ce que nous devons entendre. C’est ainsi que Paul souhaitait que ses disciples ne fussent pour ainsi dire plus des hommes, quand il leur disait : « Du moment qu’il y a parmi vous jalousie et discorde, n’êtes-vous pas des hommes5? » De même le Seigneur estimait que ses disciples n’étaient pour ainsi dire plus des hommes quand il disait : « Au dire des hommes, qui est le Fils de l’homme6? » Quand ils lui eurent rapporté la réponse des hommes, il enchaîna aussitôt : « Mais vous, qui dites-vous que je suis7? » Ainsi, lorsqu’il dit plus haut « les hommes » et ajoute ensuite « mais vous », il marqua une certaine différence entre « les hommes » et les disciples : assurément parce qu’en les initiant aux réalités divines, il les élevait au-dessus des hommes. C’est l’Apôtre qui dit : « Si donc il y a dans le Christ une créature nouvelle, les choses anciennes ont disparu8. » Et nous savons que, lors de notre résurrection, le corps est si étroitement lié à l’esprit que tout ce qui avait été passion doit être assumé dans la puissance de l’esprit. Ainsi, quiconque marche à la suite de Dieu doit se faire chaque jour l’image de sa propre résurrection : de même qu’il n’aura alors plus rien de passible en son corps, que pareillement il n’ait maintenant plus rien de passible en son cœur ; qu’il soit déjà une créature nouvelle selon l’homme intérieur, qu’il foule du pied tout ce qui a des résonances anciennes, et qu’il recherche dans ces mots anciens la seule force de la nouveauté.
L’Écriture sainte est en effet une sorte de montagne d’où le Seigneur vient en nos cœurs pour nous donner l’intelligence. C’est de cette montagne qu’il est dit par la voix du prophète : « Dieu viendra du Liban, et le Saint de la montagne ombragée et touffue9. » Cette montagne est à la fois touffue en ses pensées et ombragée en ses allégories. Mais sachons que, lorsque la voix du Seigneur résonne dans la montagne, il nous est enjoint de laver nos vêtements et de nous purifier de toute souillure de la chair, si nous nous hâtons de nous approcher de la montagne. Car il est écrit que la bête qui aura touché la montagne sera lapidée10. En effet, une bête touche la montagne lorsque ceux qui s’abandonnent à des mouvements irrationnels s’approchent des hauteurs de l’Écriture sainte et ne la comprennent pas comme ils le devraient, mais l’infléchissent d’une façon irrationnelle dans le sens de leur volupté. Car tout insensé ou tout paresseux d’esprit qui aura été vu aux environs de cette montagne est tué par les sentences les plus impitoyables comme par des pierres. Car elle est embrasée, cette montagne : parce qu’en vérité, celui que l’Écriture sainte rassasie spirituellement, elle le brûle du feu de l’amour. Aussi est-il écrit : « Ton oracle est de feu11. » C’est pourquoi, lorsque ces hommes qui faisaient route entendirent les paroles de Dieu, ils dirent : « Notre cœur n’était-il pas brûlant au-dedans de nous, quand il nous expliquait les Écritures12? » Aussi est-il dit par la bouche de Moïse : « Dans sa droite, la loi de feu13. » Par la gauche de Dieu, on entend les impies qui ne passent pas du côté droit ; la droite de Dieu, ce sont les élus, qui sont séparés de ceux de la gauche. Donc, à la droite de Dieu, la loi est de feu : parce que dans le cœur des élus, qui doivent être placés à la droite, flambent les préceptes divins et ils brûlent de l’ardeur de la charité. Que ce feu consume donc tout ce qui se trouve en nous de rouille et de vieillesse extérieures, offrant ainsi notre âme en holocauste dans la contemplation de Dieu.
Illustration : Saint Grégoire, enluminure du grand passionnaire de Weissenau, XIIe siècle (Coligny, fondation Bodmer).

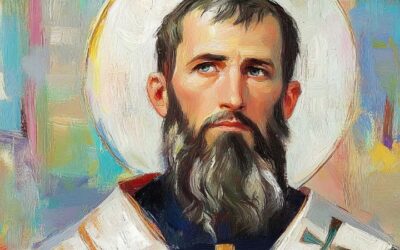

0 commentaires