Cet article est une traduction de Newman For Protestants par Carl R. Trueman, ancien professeur de Théologie Historique et d’Histoire de l’Église au séminaire théologique de Westminster et actuellement professeur au Grove City College.
J’ai découvert Apologia Pro Vita Sua de John Henry Newman lors d’une matinée pluvieuse à Cambridge en 1994. J’étais un jeune professeur de théologie médiévale et de la Réforme à l’Université de Nottingham, âgé de vingt-sept ans, et j’étais en ville pour un jour ou deux d’études. Je m’étais abrité des intempéries anglaises dans une librairie quand j’ai vu une copie de l’Apologia sur une étagère. J’ai décidé que c’était le jour où mes préjugés protestants contre l’homme le plus dangereux de l’Angleterre d’autrefois seraient confirmés. Alors cette après-midi-là, je me suis assis au coin du feu dans la chambre principale des invités à Saint Jean et j’ai lu le livre du début à la fin – non pas parce que je voulais apprendre quoi que ce soit de Newman, mais parce que je voulais le détester.
Mais en ce jour humide à Cambridge, l’histoire de la vie spirituelle de Newman ne me donna aucune raison de le détester. J’étais saisi par le langage et absorbé par les dogmes. Voici un homme qui avait posé beaucoup des questions que je me posais moi-même en tant que jeune chrétien dans mes études universitaires. Je n’ai pas pu poser le livre. Des décennies plus tard, je le garde toujours à portée de main et relis mes passages préférés. Je possède plusieurs éditions critiques. Je l’ai même sur mon Kindle.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’histoire de cette grande conversion au catholicisme romain devrait être si précieuse pour moi en tant que protestant. La prose est gracieuse, la narration intrigante, la polémique convaincante. Mais il y a plus dans Apologia que ces plaisirs littéraires. Le travail de Newman n’était pas seulement profond dans son analyse de son propre développement religieux. Elle était prophétique dans son affirmation de vérités que l’époque actuelle a finies par considérer comme des hérésies.
Si les prétendus libérateurs d’aujourd’hui dénoncent le dogme, l’histoire et l’autorité institutionnelle en tant qu’instruments d’oppression, Newman estime que ces choses sont au contraire des instruments de libération. Il savait que la liberté a besoin d’un endroit où se tenir, et que les grandes croyances de la chrétienté ont besoin d’institutions pour les maintenir. Pour un jeune universitaire comme moi, confronté à l’impact corrosif de la théorie critique sur l’enseignement supérieur, la polémique ecclésiastique de Newman contre les « excès suicidaires » de la pensée humaine effrénée conserve une pertinence puissante. Plus positivement, Newman m’a confronté à des questions auxquelles j’ai vu que je devais répondre. Quelle est l’essence du christianisme ? Comment et pourquoi la doctrine se développe-t-elle ? Quelle est la signification de l’Église institutionnelle ?
Le premier frisson de l’identification est venu au début de l’œuvre, où Newman réfléchit sur le moment auquel, même en tant que cardinal, il a daté sa conversion au christianisme :
Quand j’avais quinze ans (durant l’automne de l’année 1816), un grand changement de pensée s’est opéré en moi. Je suis tombé sous l’influence d’un Credo défini, et j’ai reçu dans mon intellect des impressions de dogme qui, par la miséricorde de Dieu, n’ont jamais été effacées ou obscurcies.
C’était ma religion qu’il décrivait, une religion qui proclame et revendique des vérités sur le passé, le présent et l’avenir, une religion d’affirmations dogmatiques. Je croyais que le Christ était Dieu incarné, que le tombeau était vide, que le Christ ressuscité est assis à la droite du Père et reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Ce ne sont pas des projections psychologiques de ma conscience religieuse. Ce sont des croyances sur le temps et la réalité. Et c’était aussi la foi de Newman. Mais il y a là une ironie : En continuant à lire, j’ai découvert que cet amour même du dogme a fini par éloigner Newman de l’évangélisme auquel je m’identifiais alors, d’abord vers le tractarianisme, puis vers Rome.
Cela me troubla. Pourquoi Newman aurait-il besoin de traverser le Tibre à la nage alors que, selon moi, cette foi dogmatique était disponible dans les articles de sa propre Église anglicane, inspirés par la Réforme ? Il aurait été facile de fermer le livre, de sourire et de dire : « Voilà la trahison ! » Mais je ne pouvais pas. Le récit de Newman – écrit en réponse à l’accusation de malhonnêteté de Charles Kingsley – était convaincant dans son honnêteté et sa cohérence, parfois douloureusement. Cela ne m’a pas conduit à crier « Traître ! » Au contraire, cela m’a permis de clarifier un problème fondamental dans mon évangélisme. Ce qui a ensuite mis en évidence l’importance de ce problème pour l’ensemble de ma foi chrétienne. J’avais commencé Apologia à la recherche de preuves contre Newman, et au lieu de cela, je me suis retrouvé à repenser ma propre approche du Christianisme.
Newman comprenait l’un des grands problèmes de l’évangélisme protestant. Tout en s’en tenant à une foi dogmatique, l’évangélisme exige plus que cela : une expérience, celle de la nouvelle naissance, et un activisme vigoureux. Historiquement, cette combinaison s’est avérée difficile. Quand les évangéliques ont été forcés de choisir, l’expérience et l’activisme ont généralement battu le dogme. Pas besoin d’être trop précis sur qui Jésus est ou ce qu’il a fait, tant que nous avons fait l’expérience de sa personne ou que nous avons parlé de lui à beaucoup de gens !
Concernant cet accent mis sur l’expérience, Newman voyait un point de contact entre l’évangélisme et le libéralisme religieux. Il définissait ce dernier comme « le principe anti-dogmatique ». Contrairement à l’évangélisme et au libéralisme, le christianisme orthodoxe a affirmé la priorité de la vérité sur l’expérience et du dogme sur la psychologie. J’étais déjà conscient des dangers de rattacher le dogmatique à l’expérientiel, mais je ne l’avais jamais vu sous cet angle. Newman m’a confronté sur mon propre terrain – celui de l’importance de l’orthodoxie doctrinale – et m’a demandé d’examiner ce que mon principe dogmatique signifiait pour ma vie chrétienne. Quelle était l’essence de l’Évangile ? Était-ce d’abord et avant tout une vérité au sujet de Dieu, ou était-ce plus lié à l’expérience humaine et à la vie pratique ? Les déclarations doctrinales étaient-elles vraies au sens objectif du terme, ou seulement en raison de leur impact subjectif dans la vie du croyant ?
Depuis que j’ai découvert Newman, ces questions sont devenues plus pressantes et plus pertinentes. Á l’époque de ce matin pluvieux à Cambridge, j’habitais un monde religieux dans lequel le dogme semblait en sécurité ; et une foi démonstrative est certainement une bonne chose. Mais maintenant, je suis convaincu que, trop souvent, le sentimentalisme et les goûts esthétiques du monde deviennent des critères pratiques déclarant avec autorité ce qui est vrai et bien. La philosophie d’Oprah s’est révélée plus mortelle pour la foi dogmatique que la critique supérieure de D. F. Strauss. Pour beaucoup de chrétiens, la vérité ne se trouve pas dans les dogmes (même s’ils les affirment), mais dans les sentiments d’accomplissement, de satisfaction et de bonheur que procure la foi.
Newman parle contre ce triomphe de l’esthétique et du thérapeutique : « Dès l’âge de quinze ans, le dogme a été le principe fondamental de ma religion : Je ne connais aucune autre religion ; je ne peux entrer dans l’idée d’aucune autre sorte de religion ; la religion, en tant que simple sentiment, est pour moi un rêve et une moquerie. »
En lisant ces lignes, je ne peux que dire « Amen ! » Enlevez le dogme et il ne reste plus rien du christianisme. L’expérience et l’activisme, sont très importants si on reconnait leur juste place, mais ils ne sont que mysticisme et pragmatisme lorsqu’ils sont détachés du dogme. Etre chrétien, ce n’est pas se livrer à une question de goût ni exprimer une préférence personnelle. C’est avant tout croire en la vérité chrétienne. La foi, aussi ardente soit-elle, est vide si on lui retire son contenu.
Cependant, en lisant et relisant Apologia, j’ai dû faire face à quelque chose que même les évangéliques les plus dogmatiques évitent souvent : la nature historique du dogme. À Oxford, Newman s’initie brièvement au libéralisme, puis en est sauvé par son étude des Pères de l’Eglise. Cette quasi-catastrophe renforça sa conviction que le christianisme patristique était le christianisme le plus pur et que l’étude de l’histoire du dogme était une partie essentielle de la tâche théologique. Je l’avais déjà su de manière irréfléchie. J’enseignais l’histoire des dogmes pour gagner ma vie. J’étais tout à fait conscient que la formulation du Symbole de Nicée sur la Trinité n’avait pas encore été pleinement formée à partir des pages de la Bible dans l’esprit de l’Église. Mais la vie est souvent compartimentée, et je n’avais jamais réfléchi sur la signification théologique de l’œuvre historique que je poursuivais.
Chez Newman, j’ai trouvé un historien de l’église d’un caractère différent. Jeune croyant, il avait lu l’Histoire de l’Église du Christ de Joseph Milner, un récit protestant standard. Il a ensuite passé des décennies à élaborer les implications de cette histoire pour sa propre foi. J’ai vu que je devais faire de même. Je savais que l’histoire de l’église que j’entendais souvent des chaires évangéliques était vraiment une hagiographie aseptisée conçue pour consoler les frères. Si Newman a fait face aux défis dogmatiques que l’histoire a posé, alors je devais en faire autant. Et si Newman pouvait passer des décennies sur cette tâche, alors moi aussi. Je pouvais difficilement considérer sa conversion à Rome comme une grande trahison si je ne voulais pas affronter les questions auxquelles il voulait répondre.
Newman a lutté avec les débats trinitaires et christologiques du cinquième siècle, et ses luttes ont été parallèles aux miennes. Je me demandais pourquoi les protestants évangéliques négligeaient si souvent le trinitarisme au profit d’une conception du salut qui ne s’enracine que de loin dans la doctrine de Dieu. Et pourquoi l’Église s’en tenait-elle à des positions telles que le dyothélitisme – l’enseignement que la personne de Jésus avait deux volontés, l’une humaine et l’autre divine, ce qui semble étranger au texte simple des Écritures ? J’avais besoin de réponses, et j’ai trouvé en Newman une source surprenante pour eux. Newman m’a orienté vers le développement dynamique des débats historiques sur les dogmes, et vers l’Église institutionnelle comme contexte et agent principal de ces débats. Il s’agissait de connexions vitales, qui n’avaient jamais été portées à mon attention par un pasteur ou un mentor chrétien.
Après avoir lu Apologia, j’ai acheté le livre An Essay Concerning the Development of Christian Doctrine. Newman y propose une compréhension de la continuité dans le dogme chrétien. J’avais trouvé que le biblicisme évangélique ne pouvait donner aucun sens à ce sujet. J’étais conscient, par exemple, que les vues qui subordonnent le Fils en voyant le Christ comme en quelque sorte un dérivé du Père avaient été acceptables au IIIe siècle mais avaient été anathématisées au IVe. Un simple appel à la Bible sans référence aux particularités historiques du débat doctrinal ne pouvait pas m’aider à comprendre pourquoi il devrait en être ainsi.
Malgré cela, le libéralisme alternatif de mes collègues universitaires semblait considérer l’histoire comme quelque chose à déconstruire, à surmonter ou à tout bonnement éviter. Mes collègues libéraux étaient encore moins intéressés par la continuité de la vérité dans la doctrine classique que ne l’étaient les biblistes purs et durs. C’était comme si la catholicité de l’Église, et même l’historicité de l’Église, n’avait aucune communication avec la théologie. Cette position me semblait intenable. Ma foi chrétienne est fondée sur l’Incarnation comme un fait historique. De même, l’Église dans laquelle j’ai été baptisé est une entité historique.
J’étais confronté à deux extrêmes : une vision de la révélation comme incapable de se développer, et une vision du développement comme incapable d’être une révélation. L’un était aussi peu plausible que l’autre. J’ai trouvé en Newman un guide doux, qui comprenait que la foi avait été définitivement livrée à l’Église, mais qui savait que l’Église était une entité historique se développant à travers le temps. Cette affirmation de la fixité apostolique et du développement historique a finalement conduit Newman à Rome. Comme il l’a écrit dans une lettre de 1844, citée dans Apologia :
En admettant que les doctrines romaines (spéciales) ne se trouvent pas élaborées dans l’Église primitive, je pense qu’il y a suffisamment de traces de celles-ci dans ladite Église, pour les recommander et les démontrer, sur la base de l’hypothèse selon laquelle l’Église serait guidée par Dieu, bien que cela ne suffise pas à les prouver par elle-même. De sorte que la question se pose simplement sur la nature de la promesse de l’Esprit, faite à l’Église.
Le dernier point fut crucial pour moi. Newman m’a amené à voir que la question du développement doctrinal conduit nécessairement à penser l’Église à la fois comme une entité historique et un réceptacle du Saint-Esprit. L’Église elle-même et son autorité pour enseigner fournissent des garanties cruciales pour voir le développement doctrinal comme l’approfondissement d’une vérité révélée continue et immuable.
Ainsi, la vision que Newman avait du développement posait un ultime défi incontournable : la nécessité de prendre au sérieux l’Église institutionnelle, une notion étrangère à mon monde évangélique, où une vision « élevée » de l’Église ne signifiait généralement guère plus que d’assister aux services du matin et du soir le dimanche. Pour Newman, une vision élevée de l’Église signifiait une vision élevée de l’autorité de l’Église institutionnelle, de ses offices et de ses sacrements. Dans l’esprit de Newman, cette haute vue révélait un lien entre le développement doctrinal, l’Église institutionnelle et la primauté de Rome. L’année fatidique de 1845 fut dominée par sa rédaction de An Essay Concerning the Development of Christian Doctrine, dont le point culminant fut sa conversion :
Pendant tout ce temps, j’ai travaillé dur sur mon Essai concernant le développement doctrinal. Au fur et à mesure que j’avançais, mon point de vue s’est tellement éclairci qu’au lieu de parler davantage des « Catholiques Romains », j’ai osé les appeler Catholiques. Avant d’arriver à la fin, j’ai résolu d’être reçu (NdT : dans la communion de Rome), et le livre demeure dans l’état où il était alors, inachevé.
La première fois que j’ai lu Apologia, j’ai été frappé par l’antithèse que Newman proposait entre le libéralisme et l’Église institutionnelle. Si le libéralisme était « le principe anti-dogmatique », alors les libéraux n’ont pas d’autre choix que celui d’adopter une vision basse du fondement du dogme, l’Église visible. J’ai été attiré par cet argument et il m’a interpellé. La critique de Newman sur l’aversion qu’a le libéralisme pour le dogme s’accordait bien avec ma propre aversion pour le libéralisme. Mais maintenant j’étais forcé de réfléchir plus sérieusement à l’Église en tant qu’institution. Dans mon monde, vous lisiez la Bible et priiez par vous-même, et l’Église ne constitue qu’un soutien à la piété individuelle. Newman m’a fait reconnaître que ce qui m’était cher – les grands dogmes de la foi, les Symboles, l’œuvre de Dieu dans et à travers l’histoire – supposait l’Église institutionnelle. L’Église donne à la foi une force historique et une solidité certaine en définissant le dogme et en l’enseignant avec autorité.
Pour Newman, cette logique a mené à Rome. Dans son Essay, il a déclaré que « être profond dans l’histoire, c’est cesser d’être protestant. » Ici, il m’a certainement mis au défi, et m’a défié profondément, mais à la fin nous nous sommes séparés. C’est une chose de plaider pour le développement du trinitarisme et une autre de plaider pour le développement du dogme marial ou de la primauté romaine. En tant que protestant, je pouvais voir la base exégétique de la première, le dogme se développant comme le résultat de débats sur des textes bibliques. Mais le dogme marial est trop libre de tout mandat biblique, et la primauté romaine a trop compliqué l’histoire pour que je puisse voir clairement la main de Dieu derrière elle. La primauté romaine semble être un exemple d’autorité ecclésiastique qui se valide elle-même plutôt que de servir d’instrument pour une élaboration providentielle des vérités scripturaires. Dès le début, j’ai aimé Newman. Contre toute attente, je l’ai admiré. Mais sur Marie et Rome, je ne pouvais pas me résoudre à le croire.
Néanmoins, à ce jour, j’apprécie sa démarche provocatrice et son style « tout ou rien ». Il soulève une question que tous les chrétiens attentionnés doivent à un moment donné aborder : Comment identifier la véritable tradition de l’enseignement chrétien à travers l’histoire, et quel rôle l’Église joue-t-elle dans cette tradition ? Les mots « être profond dans l’histoire, c’est cesser d’être protestant » sont inscrits sur ma tasse à café préférée, me rappelant quotidiennement les enjeux pour lesquels nous, théologiens historiques, jouons. Être dans les profondeurs de l’histoire, c’est certainement, par exemple, cesser d’être un évangélique qui laisse ses expériences l’emporter sur la doctrine, qui croit que la doctrine peut être lue à la surface du texte biblique, et qui ne voit aucun problème théologique ou existentiel qui ne puisse être résolu avec un texte ou deux des Écritures.
Mais ce type d’évangélisme n’est pas le protestantisme classique. Ironiquement, en me ramenant à l’histoire et en me pressant de répondre aux questions sur le dogme, le développement et l’Église institutionnelle, Newman m’a fait apprécier Rome et m’a convaincu que je ne pourrais jamais en faire mon foyer. L’histoire témoigne (comme le fait remarquer Newman) que l’évêque de Rome était relativement peu important, même aux IVe et Ve siècles bien-aimés de Newman, dont l’étude lui a fait renoncer à l’anglicanisme. Et depuis lors, l’histoire a soulevé suffisamment de questions sur la compétence dogmatique de la papauté pour faire réfléchir même les catholiques romains les plus convaincus.
Ainsi, même si Newman m’a éloigné d’une grande partie de l’évangélisme, il m’a conduit non pas à Rome, mais à Genève et au protestantisme réformé traditionnel – une religion qui évite le défilé de l’expérience religieuse personnelle, considère les sacrements comme cruciaux et prend au sérieux son lien, à travers les grands crédos œcuméniques, avec un christianisme qui est plus grand que ses expressions locales ou même ses manifestations dénominationnelles et confessionnelles.
Je n’avais aucune idée, en ce jour pluvieux à Cambridge, qu’en ouvrant Apologia de Newman, je découvrirais non pas un ennemi mais un ami de toujours, non pas un victorien poussiéreux mais un penseur vital, et non pas un catholique insistant sur le fait que je dois me convertir mais un guide vers un protestantisme plus vrai. Depuis lors, Newman a été mon compagnon et mon interlocuteur amical. Lorsque je prends le café dans ma tasse de café Newman et que je rumine sur la légende qu’il porte, j’ai tendance à le considérer comme un mentor qui m’a posé les questions auxquelles tous les chrétiens devraient pouvoir offrir une réponse.


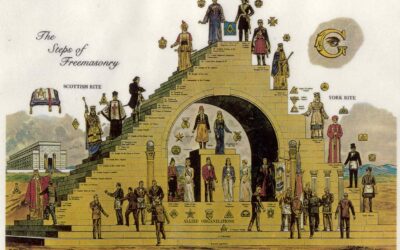


0 commentaires