Pourquoi un nombre important de diplômés évangéliques de grandes écoles, ainsi que certains intellectuels protestants de renom, ont-ils traversé le Tibre ces dernières années ?
Les gens ont plus d’une raison (qu’ils le sachent ou non) de changer leurs attaches religieuses. La conversion est généralement un processus à plusieurs niveaux. Dans cette série, nous avons examiné les dimensions (1) psychologique, (2) théologique et (3) sociologique de la conversion. Comme l’a fait observer le célèbre catholique converti du protestantisme John Henry Newman, « Lorsque les hommes changent réellement et véritablement d’opinion religieuse, ce n’est pas seulement leurs opinions qu’ils changent, mais aussi leur cœur ; et cela ne se fait évidemment pas en un instant – c’est un travail lent ».
Pour tenter de faire face à ce phénomène, nous allons donc examiner les domaines qui traitent de ces trois dimensions de la « conversionite » : (1) notre identité, (2) notre vision du Christ, et (3) notre compréhension de la mission de l’Église. Ces domaines traceront les débuts d’une voie à suivre et nous permettront d’offrir à ceux qui se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur de nos Églises une alternative véritable, convaincante et satisfaisante à la religion romaine.
I. Une identité enracinée dans l’histoire
Derrière de nombreuses défections de l’orthodoxie chrétienne ou du protestantisme évangélique se cache un déficit psychologique fondamental : l’absence d’amis et de père. La plupart d’entre nous n’ont pas le réseau dense de relations qui a soutenu nos ancêtres chrétiens, que ce soit les pairs avec lesquels partager nos triomphes et nos doutes, ou les pères et mères dans la foi pour nous ancrer et nous guider au milieu de la confusion. Si nous devons répondre avec vérité à cette crise, nous devons aussi y répondre avec amour. Les besoins émotionnels des personnes vivant dans un monde à la dérive ne sont pas moins importants que leurs besoins intellectuels.
Nous vivons à une époque où la question la plus urgente qui se pose à nos esprits et à nos lèvres est la question la plus fondamentale de toutes : « Qui suis-je ? ». À notre époque, cette question de l’identité a été mise au premier plan et a provoqué des crises apparemment insolubles tant pour notre politique que pour l’Église.
Cela ne devrait pas nous surprendre. L’identité, après tout, se trouve à l’intersection instable de l’appartenance et de l’unicité. Ce que je suis est façonné par la famille à laquelle j’appartiens, le lieu auquel j’appartiens, la nation à laquelle j’appartiens, les vocations que j’occupe. Et pourtant, elle ne peut se réduire à ces choses ; chacun de nous est également unique. Cela est également vrai si nous échangeons une lentille sociologique contre une lentille théologique. Qui suis-je ? Un enfant de Dieu, adopté dans le Christ Jésus, un frère ou une sœur dans la famille de l’Église. J’appartiens à un groupe, et pourtant Dieu m’appelle par mon propre nom. De même, bien que chaque église puisse appartenir à une certaine dénomination, et chaque dénomination au corps plus large du Christ, chacune a aussi sa propre histoire et son propre appel donné par Dieu.
Au cours des dernières décennies, la société et l’Église ont toutes deux cherché à mettre l’accent sur le caractère unique de l’individu, le « je » par opposition au « nous ». La perte de sens qui en résulte, le sentiment d’être « jeté dans le vide », selon les termes d’Oliver O’Donovan, a déclenché un violent retour en arrière vers le « nous », le langage de la solidarité et des « groupes identitaires ».
L’Église souffre au même titre que la culture au sens large, ne sachant pas comment honorer les revendications de la conscience individuelle auxquelles nous nous sommes tellement habitués, tout en retrouvant un sentiment d’appartenance à une véritable communauté, et à une tradition théologique qui n’est pas née de la dernière pluie. Pour beaucoup d’évangéliques sans racines, la revendication de catholicité de Rome, ou peut-être les revendications de tradition de l’orthodoxie grecque, offrent un moyen de sortir de cette tension et de retrouver un sentiment d’enracinement.
Ces tentations ne sont cependant pas aussi nouvelles qu’on pourrait l’imaginer. Les réformateurs protestants se sont également battus pour savoir ce que signifiait être fidèle au passé de l’Église, s’y identifier, tout en répondant à l’appel réformateur de l’Esprit dans le présent. Si beaucoup aiment à citer le « Me voici » de Luther comme une défense héroïque de la conscience individuelle, nous sommes moins enclins à citer ou même à nous remémorer les appels volumineux des réformateurs aux Pères, à la philologie, à la philosophie et au rôle légitime des autorités humaines dans l’Église et l’État pour ancrer la conscience individuelle dans une période de changement et de bouleversement. La Réforme n’a pas offert une nuda Scriptura1 simpliste de l’individualisme religieux, mais une vision riche et nuancée de la manière de s’orienter dans le respect de l’autorité de la Parole et de nos autorités dans le monde, de la manière de grandir dans la liberté d’un chrétien, homme ou femme, qui est aussi le serviteur dévoué de tous.
Parmi les représentants d’une telle vision, le plus éminent était certainement Richard Hooker, qui voyait clairement ce qu’une acceptation généralisée du principe du jugement privé ferait à l’Église :
Dès aujourd’hui, nous voyons qu’elle a déjà conduit des milliers dans l’erreur si flagrante de penser qu’un homme qui peut à peine prononcer cinq mots de façon rationnelle n’a pas honte de penser qu’en matière d’Écriture, sa propre opinion privée l’emporte sur tous les jugements sages et sobres du monde entier. Une telle insolence doit être contenue, sinon elle sera le fléau de la religion chrétienne !
HOOKER Richard, Laws of Ecclesiastical Polity, II.7.6, trad. personnelle.
Remarquez ce que Hooker oppose à « l’opinion privée ». Il ne s’agit pas des décrets du magistère papal ou même d’un quelconque idéal haletant de la tradition ecclésiastique, mais plutôt de « tous les jugements sages et sobres du monde entier ». Hooker fait appel, en d’autres termes, à ce que nous pourrions appeler l’exercice corporatif de la raison. Ce n’est pas tout à fait la « raison » ou la « tradition » que l’on vante souvent dans le trompeur « trépied anglican » : il s’agit plutôt des deux ensemble, la « raison » étant le nom de ce que nous faisons lorsque nous raisonnons ensemble dans le présent (guidés par les personnes les plus compétentes et les plus savantes), et la « tradition » le nom du dépôt de ce raisonnement au fil des générations et des siècles. Nous respectons cette tradition raisonnée principalement pour la même raison que nous devrions respecter la sagesse éprouvée et les jugements soigneusement étudiés des savants dans n’importe quel domaine.
Hooker ne prétend jamais que ces autorités humaines sont au-dessus de l’erreur, en hochant la tête dans le sens du discours de Luther à Worms :
Même si dix mille conciles d’église offraient le même jugement sur n’importe quel point de religion, une seule preuve irréfutable de la raison, ou un seul témoignage sans ambiguïté de l’Écriture, l’emporterait sur tous. Il est possible que les conciles se trompent, mais il est tout à fait impossible que la raison démonstrative ou le témoignage divin se trompent.
HOOKER Richard, Laws… I,I.7.5, trad. personnelle.
Mais nous ne nous trouvons pas souvent en présence de telles certitudes, surtout lorsqu’elles nous sont imposées par ceux qui prétendent avoir une parole nouvelle du Seigneur ou une révélation de l’Esprit qui contredit l’histoire de l’interprétation des Écritures. Et, dit Hooker, « lorsque nous manquons d’une preuve infaillible, l’esprit préfère suivre des arguments probables plutôt que d’embrasser des affirmations sans aucune raison valable ». Les meilleurs de ces arguments probables sont ceux fournis par une solide érudition, un consensus historique, une pratique établie et les ordres des autorités que Dieu a placées directement dans nos vies. La reprise de la doctrine évangélique dans les premières années de la Réforme ne doit pas être considérée comme la nouvelle norme — comme si nous devions chercher un nouveau cadre théologique à chaque génération, tout comme Jefferson voulait une nouvelle convention constitutionnelle tous les dix-neuf ans — mais comme un moment spécial de réveil spirituel et de « retour aux sources » comme Dieu n’en envoie que rarement dans la vie de l’Église.
Hooker rappelle à ses lecteurs que la Réforme n’a jamais été conçue comme une rupture nette avec le passé, mais plutôt comme une tentative d’élaguer les pires corruptions qui avaient grandi et empêtré l’Église de la fin du Moyen Âge, afin que la lumière de l’Évangile puisse à nouveau briller et renouveler la vie historique de l’Église : « Nous pouvons certainement espérer que ceux d’entre nous qui se réforment là où ils se sont égarés ne se coupent pas ainsi de l’Église des âges précédents. Nous étions alors dans l’Église et nous y sommes toujours »2.
De même, nous devons garder le cap dans les nouveaux conflits identitaires de notre époque. Nous ne devons pas fuir vers le passé et abandonner l’appel unique du Seigneur à la fidélité dans notre moment présent. Nous ne devons pas non plus fuir notre passé dans notre empressement à prouver notre solidarité avec ceux qui ne le partagent pas, comme le proclament aujourd’hui les prophètes de la wokeness. Nous devons affirmer notre vocation en tant qu’individus, attentifs à l’appel de l’Esprit, sans retomber dans l’individualisme qui a rongé les fondements de nos Églises et de notre politique. Nous réaliserons cet équilibre non pas en nous concentrant sur nous-mêmes et sur notre histoire, mais en regardant Celui qui règne sur toute l’histoire et qui la mènera un jour à son terme.
II. Une vision du Christ
Tout comme aujourd’hui, l’Église romaine du XVIe siècle comprenait le statut de personne pardonnée comme étant pleinement et finalement réalisé dans l’aboutissement d’un processus religieux, un état sanctifié qui mettait l’accent sur les œuvres méritoires comme étant nécessaires à l’acceptation divine. Les réformateurs, cependant, ont insisté sur le fait que cette croyance a supplanté la personne et l’œuvre du Christ de la foi chrétienne, la remplaçant par une introspection spirituellement nuisible. Le catholicisme romain de la fin du Moyen Âge a souvent communiqué cette approche de la justification centrée sur les œuvres en présentant Jésus comme assis sur un siège de jugement au décor d’arc-en-ciel. Le Seigneur en tant que juge était flanqué de sa mère, Marie, et de Jean-Baptiste, positionnés comme intercesseurs contre sa terrible colère. Ce Jésus, selon les réformateurs, ne peut pas nous aider, mais nous pousse plutôt à fuir pour trouver refuge ailleurs (auprès de Marie et des autres saints). Une telle incompréhension de la bonne nouvelle de Dieu a poussé beaucoup d’entre eux à fuir la communion avec Rome.
Le salut, pensaient les réformateurs, était devenu une marchandise à négocier, à acheter et à trafiquer. Il avait été transformé en un produit d’innovation magistrale et n’était plus la bonne nouvelle du christianisme apostolique. Bien sûr, Luther, Calvin, Zwingli et d’autres ont reconnu que la formule nominaliste facere quod in se est (faites ce qui est en vous3) avait été développée dans un contexte pastoral, une tentative d’amener les marginalisés à une communion plus active. Cependant, ils ont fait valoir que la notion selon laquelle les pécheurs peuvent mériter une justification par leur comportement religieux produisait non pas le salut mais un légalisme scrupuleux et, en fin de compte, un désespoir personnel. Selon les termes de Vermigli :
Si nous, comme les Sophistes, commandions à une personne d’avoir égard à ses propres œuvres [devant Dieu], elle ne trouverait jamais de réconfort, serait toujours tourmentée, toujours dans le doute de son salut et finalement, serait engloutie par le désespoir.
Dans ce creuset d’angoisse, les réformateurs se sont penchés sur la question centrale suivante : Pourquoi le Dieu Tout-Puissant — le Saint qui demeure dans une lumière inaccessible — accueille-t-il des hommes et des femmes pécheurs comme ses enfants ?
Contrairement à la conception romaine de la justification, les réformateurs ont reconnu l’incapacité de l’humanité à obtenir la moindre mesure du mérite divin. La persistance du péché dans la vie d’un croyant l’empêche. Même les exemples les plus purs et les plus héroïques de la vertu humaine restent entachés par la chute. Nous sommes tous en deçà de la norme divine. « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux », a dit Jésus (Mt 5:20).
Et même le religieux le plus scrupuleux, qui peut se sentir optimiste en regardant la barre des Pharisiens, devrait admettre sa défaite après la prochaine stipulation de Jésus : « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5:48). Le sang expiatoire du Fils de Dieu est le seul véritable solvant de la culpabilité humaine, car c’est par lui seul que nous sommes « adoptés comme ses enfants et faits héritiers de la vie éternelle ».
Mais cette vision du Christ, qui met en évidence l’Évangile de la grâce, ne doit pas conduire à une apathie spirituelle. Les réformateurs ont enseigné que même si les meilleures œuvres d’un individu sont entachées de péché et ne sont pas à la hauteur de la gloire de Dieu, elles comptent néanmoins pour Dieu et lui donnent du plaisir. C’est pourquoi les bonnes œuvres doivent être poursuivies avec le plus grand sérieux. S’opposant à la conception des bonnes œuvres comme fondement de notre salut, les réformateurs ont cherché à éviter une erreur à l’autre extrême — dénigrer les bonnes œuvres en raison de leur imperfection, sapant ainsi l’incitation du chrétien à vivre saintement.
« Car nous ne rêvons ni d’une foi dépourvue de bonnes œuvres, ni d’une justification qui en serait dépourvue », a déclaré Calvin. C’est précisément parce que nous nous approchons de Dieu en tant qu’enfants adoptés en Christ sans nous fier à notre mérite, que nous trouvons la grâce paternelle de Dieu embrassant nos œuvres avec un sourire, de la même manière qu’un père chérit le dessin au crayon de sa fille. Selon les mots de Calvin, nous « encourageons et réconfortons remarquablement le cœur des croyants par notre enseignement, lorsque nous leur disons qu’ils plaisent à Dieu dans leurs œuvres et qu’ils sont sans aucun doute acceptables pour lui ».
Il n’a pas fallu longtemps pour que cette nouvelle vision du Christ commence à remodeler la conception de l’Église sur le culte en assemblée. Contrairement à l’approche de Rome qui se concentrait sur l’autel et un prêtre de langue latine qui se détournait de la congrégation pour propitier Dieu en leur nom, la Réforme a promulgué des réformes liturgiques qui ont uni tout le peuple de Dieu à la Parole de Dieu. Ils ont tourné le ministre vers la congrégation : Le Christ n’était plus la propitiation sacrificielle offerte par le prêtre au Père, mais le don de Dieu pour le peuple de Dieu. Luther et les autres protestants ont même chanté en réformant, incitant un laïc autrefois silencieux à louer Dieu dans sa sainteté. Comme l’a dit Luther, « à côté de la théologie, je donne à la musique la plus haute place et le plus grand honneur ».
Malheureusement, dans de nombreux milieux du protestantisme, une fièvre cathophobe commença à saper le travail merveilleux mais méthodique de réforme liturgique que des hommes comme Luther, Calvin et Cranmer avaient entrepris. Comme Richard Hooker devait le déplorer à la fin du XVIe siècle, « Chaque nouvelle Église réformée qui se présentait aspirait à s’éloigner encore plus de toute allusion à l’Église de Rome que les Églises qui l’avaient précédée. Ainsi, dans la pratique, elles s’éloignaient de plus en plus les unes des autres, et il en résultait beaucoup de conflits, de jalousie, de discorde et de mauvais sang entre elles ».
Cela fut particulièrement vrai en Amérique, d’abord peuplée de dissidents liturgiques qui étaient prêts à dériver sur un océan à part pour poursuivre leur culte « pur ». Nous sommes les héritiers de ce mauvais sang et du chaos liturgique qui en a résulté. Les réformateurs se sont efforcés de rétablir un équilibre délicat entre la Parole et le Sacrement dans le culte, en rapprochant l’esprit et le cœur, l’âme et le corps, l’individu et la communauté. Peu d’Églises protestantes aujourd’hui préservent cet équilibre ; en effet, beaucoup de nos Églises se préoccupent davantage de trouver le juste équilibre entre l’heure du café et l’heure du concert de louange.
Si nous voulons retrouver le protestantisme de la Réforme à notre époque, nous devons retrouver un culte juste. « Ce que, intérieurement, chaque homme devrait être », écrit Hooker, « l’Eglise devrait témoigner extérieurement… Les signes doivent ressembler aux choses qu’ils signifient… Ainsi, l’exercice public de la religion est mieux ordonné lorsque l’Église militante ressemble visiblement et raisonnablement, autant qu’elle le peut, à la dignité et à la gloire cachées avec lesquelles l’Église triomphant au ciel est embellie. » Par le culte, nous proclamons notre identité en tant qu’Église, épouse du Christ, montant au ciel pour le repas de noces de l’Agneau.
Nous venons, bien sûr, conscients de notre besoin de grâce et de pardon. Mais, nos péchés confessés, nous montons ensemble avec confiance vers le Saint des Saints, revêtus de la Justice du Christ, prêts à rejoindre les chœurs de louanges devant Son trône, nous incitant les uns les autres à un amour plus grand et à une gratitude plus profonde.
Les protestants magistériels, malgré la diversité de leurs liturgies historiques, ont cherché à préserver cette posture de culte communautaire, confiante et centrée sur le Christ. Là où nous l’avons perdue, nous devons nous efforcer de la retrouver et de l’offrir aux âmes affamées de notre époque.
III. Une vision de la mission de l’Église
Bien que certains d’entre nous soient spécifiquement appelés à être pasteurs et missionnaires, la Réforme nous rappelle que nous sommes tous appelés à servir la parole de Dieu, toujours prêts à donner une réponse à ceux qui la demandent, en utilisant les dons que le Seigneur nous a donnés, car l’Esprit sanctifie nos tâches les plus humbles.
Lorsque la Réforme a souligné que les chrétiens ordinaires (personnes sans ordination sacerdotale ni diplôme universitaire) pouvaient lire et comprendre le message de salut de la Bible sans l’aide de l’enseignement de l’Église romaine, elle a renouvelé la vision de l’Église sur la mission chrétienne. En lisant le texte, les chrétiens ont perçu que le sacerdoce du Christ s’étendait à chaque croyant, conférant à des vocations temporelles telles que l’agriculture et la forge une nouvelle dignité et un nouveau but. Avec le temps, ce « sacerdoce des croyants » allait devenir une caractéristique déterminante de l’identité protestante.
Les réformateurs n’ont pas cherché à se débarrasser d’un clergé ordonné. Ils ont reconnu que le Nouveau Testament établissait des formes et des fonctions particulières de direction de l’Église. Il est clair que Luther, Calvin et d’autres réformateurs du Magistère occupaient des postes d’autorité pastorale et théologique et estimaient que ces postes étaient indispensables à la vie de l’Église. Mais ils ont renoncé à la doctrine romaine selon laquelle le prêtre ordonné a un rôle de médiateur entre Dieu et le chrétien. Car comme l’affirme 1 Timothée 2:5, « il n’y a qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Jésus-Christ ».
Les réformateurs n’ont pas non plus cherché à se débarrasser des outils de la sagesse temporelle. Comme Richard Hooker l’a écrit de façon mémorable dans ses Laws of Ecclesiastical Polity, « La sagesse enseigne aux hommes toutes les bonnes voies, mais elle n’enseigne pas toutes les bonnes voies de la même façon. Tout ce que les hommes ou les anges savent n’est qu’une goutte de sa fontaine inépuisable, et elle a dispersé ses trésors dans le monde entier de diverses manières. Et comme ses voies sont multiples, les différentes manières qu’elle a d’enseigner le sont aussi. Elle nous révèle certaines choses par les livres sacrés de l’Écriture et d’autres par les œuvres glorieuses de la nature. Elle enseigne certaines choses par une influence spirituelle venant d’en haut, et d’autres uniquement par l’expérience et la pratique dans le monde. Nous ne devons pas admirer une de ses méthodes de travail au point de la déshonorer dans une autre, mais adorons plutôt toutes ses méthodes selon leur place et leur degré ».
Les réformateurs se sont consacrés à l’Écriture par-dessus tout, mais pas à l’exclusion de tout le reste. Ils étaient (ou du moins, aspiraient à être) versés dans la science et la philosophie, dans l’art et la littérature, dans la logique et la rhétorique, dans le droit et la politique. Ils étaient des étudiants passionnés d’histoire et de nature humaine. En un mot, ils étaient des humanistes.
Aujourd’hui, ce mot est tombé en discrédit chez certains croyants. Mais même si les chrétiens continuent à tirer la sonnette d’alarme sur l' »humanisme séculier », le monde a évolué et est plus susceptible d’être « posthumaniste » ou « transhumaniste ». Les chrétiens devraient apprécier toute personne qui s’engage à étudier la nature humaine, car l’humanité est le couronnement de la création de Dieu. Nous ne saisirons le péché humain et la grâce divine que si nous comprenons la nature humaine que le péché entache et que la grâce restaure et perfectionne.
La catéchèse de base et le soin des âmes, qui étaient autrefois des éléments fondamentaux du ministère de l’Église, ont connu des temps difficiles. Les pasteurs ne sont plus formés à la sagesse et à la perspicacité holistiques qui pourraient faire le lien entre les domaines de la révélation naturelle et spéciale, les principes bibliques et le savoir-faire de la cure d’âme. Et qui peut les blâmer, alors que nos séminaires doivent ramasser les morceaux d’un système d’enseignement supérieur brisé, offrant une école spirituelle de trois ans aux ordinands qui n’ont jamais reçu des outils d’apprentissage ?
La catéchèse chrétienne, lorsqu’elle existe, sort rarement du moule de l’étude piétiste de la Bible ou du séminaire sur les « questions contemporaines ». Aujourd’hui, nous formons plus de théologiens au niveau du doctorat que jamais auparavant, mais, semble-t-il, moins de professeurs dans l’Église capables de guider patiemment les paroissiens à travers les multiples couches du récit biblique et le riche héritage de l’histoire de l’Église. Pendant ce temps, nos laïcs, de plus en plus conditionnés à considérer l’Église comme un engagement d’une heure le dimanche matin, qu’ils doivent intégrer dans leur mode de vie chargé, peuvent rarement prendre le temps de faire de la catéchèse, même lorsqu’elle est proposée.
Notre époque est celle du bouleversement et de la réforme de l’éducation. Le mouvement d’éducation chrétienne classique du passé récent a fait de grands progrès en retrouvant des aperçus de ce qu’offrait autrefois un humanisme chrétien plus ancien. Le temps est venu de faire passer cette réforme à un niveau supérieur, c’est-à-dire de la ramener dans les Églises.
Le ministère de l’Église, reconnu par les réformateurs, est un ministère d’enseignement, et doit donc être un ministère d’apprentissage. Tout au long du XVIe siècle, on rencontre de longues lamentations sur l’ignorance des curés et les efforts dévoués de renouvellement de l’éducation. Ces efforts ont porté leurs fruits au cours du siècle suivant, si bien que dans les années 1620, par exemple, on disait Clerus Anglicanus stupor mundi — « le clergé d’Angleterre est la merveille du monde », en raison de la profondeur et de l’étendue de son savoir. L’essentiel de l’apport des Lumières n’a pas été le résultat de la rébellion intellectuelle des philosophes athées ; c’est la fécondité intellectuelle des universités et des séminaires protestants, qui ont créé une culture de l’apprentissage et de la découverte, du droit et de la liberté. C’est notre héritage ; il est temps que nous le revendiquions.
De plus, face à la crise d’identité actuelle où beaucoup sont tentés par les revendications historiques de Rome, nos Églises doivent être fortement ancrées dans le sol de notre passé catholique sans oublier l’appel à une réforme constante. Cela signifie, tout d’abord, que nous devons rappeler et enseigner patiemment à notre peuple que la véritable Église n’est pas née toute entière hier, et certainement pas il y a cinq siècles. Bien que nous remercions Dieu pour ce qu’il a fait pendant la Réforme, nous nous souvenons que notre héritage ecclésiastique a commencé à la Pentecôte, s’est poursuivi après la chute de Rome, a grandi et s’est affiné au fil de nombreux conciles et controverses, et s’exprime sous de nombreuses formes et cultures. Les réformateurs ne lançaient pas une révolution, comme si des concepts théologiques tels que la foi et la grâce étaient d’étranges ajouts à la vie de l’Église. Ils étaient des radicaux au vrai sens du terme, remontant aux racines de la foi chrétienne historique telle que promulguée par les apôtres et les plus grands Pères de l’Église.
Nous ferions donc bien de souligner notre lien, dans la mesure du possible, avec ce qui nous a précédés. Les gens recherchent un sentiment d’appartenance enraciné, et il est juste, tant historiquement que pastoralement, que nous répondions en partageant cette vérité. Pourquoi ne pas mentionner, comme il se doit, certains des grands croyants du passé — Calvin, oui, mais aussi Chrysostome, Augustin, Anselme et Thomas — dans nos cultes et dans nos sermons ? S’il n’y a rien de mal à souligner nos spécificités confessionnelles — en fait, il serait impossible de ne pas le faire — nous avons une dette de gratitude énorme envers ceux qui nous ont précédés. Il est temps que nous commencions à la payer.
Conclusion
Nous avons commencé cette série en citant l’érudit évangélique Mark Noll, qui a admis de manière provocante : « Le scandale de l’esprit évangélique est qu’il n’y a pas vraiment d’esprit évangélique ». C’était il y a plus de deux décennies, mais son point de vue (à de nombreuses exceptions dignes d’intérêt dispersées dans le paysage nord-américain) tient toujours. En effet, ce scandale a assez duré pour que beaucoup soient prêts à fermer les yeux sur les propres scandales de Rome et à se réfugier dans la profondeur intellectuelle, l’ampleur historique et l’autorité réconfortante de la Mère Église.
Nous pouvons et devons en effet sympathiser avec le désir de renouer avec le passé au milieu d’une postmodernité sans racines. Mais en tant qu’héritiers de la Réforme, nous devons maintenir un équilibre biblique de respect des traditions et des événements du passé avec une ouverture à la réforme dans le présent et dans l’avenir. Si la Réforme nous dit quelque chose, c’est que même les bons navires — comme l’Église catholique — peuvent prendre un mauvais cap lorsqu’ils sont pilotés par des hommes pécheurs.
De nos jours, l’héritage de la Réforme s’est lui-même beaucoup égaré, du moins parmi ceux qui prétendent marcher sous ses bannières. Le matérialisme et la mondanité, la piété égocentrique et le culte individualiste, le subjectivisme et la superstition, l’absence de responsabilité des dirigeants de l’Église et la perte des connaissances bibliques de base que les réformateurs déploraient sont désormais monnaie courante dans les Églises du protestantisme évangélique. Si nombre de nos meilleurs et plus brillants éléments semblent fuir nos Églises à la recherche de pâturages spirituels plus verts, nous ne pouvons guère être surpris. Mais la solution, comme nous l’avons vu dans cette série, est de creuser plus profondément dans la Réforme, et non de la fuir.
Les convertis protestent que l’Église d’aujourd’hui a besoin de renouer avec son passé. Nous sommes d’accord. Mais cette reprise du passé ne peut pas être sélective, en passant sous silence les corruptions grossières de l’Église médiévale et les abus du pouvoir papal, et en ignorant le grand travail de réforme et de renouveau du XVIe siècle. L’héritage de l’Église catholique est à chérir et à nourrir ; mais il en va de même de l’héritage de la réforme qui a nettoyé et affiné ce legs — et surtout, derrière les deux, l’illumination toujours ancienne et toujours nouvelle de la Parole vivante de Dieu, par laquelle l’Église prend forme à chaque époque.


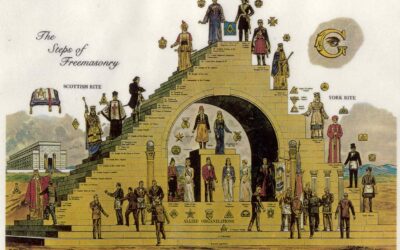


0 commentaires