Nous présentons ici en traduction française des extraits choisis (par Dominic Foo) d’un article de Richard H. Popkins, “Skepticism and the Counter-Reformation in France” (texte intégral anglais disponible ici).
Cette exploration de la Contre-Réforme en France tentera de retracer et d’expliquer l’un des développements les plus étranges de cette période : l’alliance des catholiques les plus orthodoxes avec les disciples les plus sceptiques de Montaigne dans une croisade commune contre le calvinisme.
[…]
Le groupe dominant et dominateur des théologiens catholiques français semble avoir été intimement lié à la tradition de Montaigne, de sorte que la période de la Contre-Réforme française englobe un pot-pourri de figures comme le fils adopté de Montaigne, le père Charron, archi-sceptique, le cardinal du Perron qui fut l’artisan de la conversion d’Henri IV, l’héroïque François de Sales, son secrétaire pyrrhonien, Monseigneur Jean-Pierre Camus, Gentian Hervet, le traducteur de Sextus Empiricus, ainsi que secrétaire du cardinal de Lorraine ; mais aussi les grands disputeurs jésuites, les pères Gontery et Véron, la fille adoptive de Montaigne, Mile, de Gournay, et enfin des amis et protégés des cardinaux Richielieu et Mazarin comme La Mothe Le Vayer et Gabriel Nauder, ses disciples et ses amis de dernière date. Comme nous le verrons, le groupe des sceptiques et des dirigeants catholiques s’entendait cordialement à la fois sur la théorie et sur la Contre-Réforme, mais probablement pas sur la foi.
L’objectif de cette étude sera d’explorer les fondements intellectuels de cette alliance, et de montrer que type d’argumentation contre le calvinisme menée par les contre-réformateurs français indique pourquoi des sceptiques se sont associés aux apologètes catholiques. En matière d’anticalvinisme en France, les sceptiques peuvent bien avoir été les théoriciens, ou avoir fonctionné comme les théoriciens du monde théologique français post-tridentin. Nous retracerons à la fois l’histoire d’un aspect de la Contre-Réforme française et l’ascension des sceptiques français vers le leadership intellectuel au début du XVIIe siècle, qui sont deux phénomènes liés. Dans un deuxième temps, nous verrons qu’après que cette étrange alliance a conduit à une croisade réussie contre le calvinisme, l’opposition interne entre catholiques et sceptiques est devenue évidente, et que l’alliance s’est dissoute progressivement. Pour comprendre cette union de sceptiques et de responsables ecclésiastiques, il faut d’abord examiner les moyens par lesquels les catholiques ont tenté de soumettre intellectuellement les calvinistes, puis étudier la raison d’être de cette méthode, et la comparer au « scepticisme théologique » développé par les disciples de Montaigne.
En France, au milieu du XVIe siècle, le calvinisme se développe très rapidement. En quelques années, le pays s’est enlisé dans une guerre civile, tant au plan militaire qu’intellectuel. Le succès des calvinistes sur ce dernier front exigeait des mesures drastiques pour empêcher la prise des citadelles de la pensée française par les réformateurs. Deux événements remarquables ont eu lieu dans les années 1560 pour assurer la position intellectuelle catholique. L’une était la publication en latin des écrits du sceptique grec Sextus Empiricus, et l’autre l’installation à Paris d’un des plus grands controversistes jésuites, Juan Maldonat. À la suite de ces événements, « une nouvelle machine de guerre » a été façonnée pour détruire le calvinisme sur le champ de bataille intellectuel.
[…]
L’étape suivante, la perfection de la « nouvelle machine de guerre » était de faire de l’attaque une série systématique d’applications de difficultés sceptiques qui pousseraient les calvinistes dans une crise pyrrhonienne insoluble. Cette évolution est due à deux ardents défenseurs de l’ordre des Jésuites, les pères Jean Gontery et François Véron. Ce dernier, dont nous suivrons la présentation, est un personnage fabuleux de la Contre-Réforme. À l’origine, l’un des professeurs jésuites de La Flèche (lorsque Descartes y était étudiant), Veron, est devenu si talentueux pour lutter contre la Réforme que, libéré de ses fonctions de professeur, puis de son ordre, il a été fait porte-parole officiel de la foi pour le roi de France.
[…]
Chaque texte, affirmait Véron, prend son sens en se basant sur une interprétation des symboles, et ensuite en déduisant un sens du texte. Le texte n’est pas accompagné d’une interprétation intégrée. Il ne contient pas d’énoncés sur la manière dont les divers recueils de lettres doivent être lus, ni sur ce qu’ils signifient. Une telle décision entraîne une conséquence qui n’est pas contenue dans l’Écriture elle-même. Il s’agit à la fois d’abandonner l’affirmation non biblique des protestants, selon laquelle l’Écriture seule est la règle de la foi, et de présenter une base d’interprétation qui ne soit pas sujette à l’erreur. La persuasion intérieure comme norme d’interprétation est accompagnée de toutes sortes de difficultés bien connues, liées à la définition du canon. Elle est invérifiable, peut être illusoire, variable, etc. Si les protestants reviennent ensuite à la position que leur interprétation consiste uniquement à tirer des conclusions logiques évidentes de ce que dit l’Écriture, ceux qui possèdent cette « machine de guerre » sont prêts à dévaster cette nouvelle ligne de défense. Tout d’abord, ce n’est pas une affirmation biblique, puisque l’Écriture ne présente aucune règle d’inférence. Deuxièmement, en raison de la faillibilité de l’humanité, on peut toujours se tromper quant à savoir si l’on a tiré les bonnes conclusions. S’il est toujours possible qu’on se soit trompé, on doutera toujours d’avoir trouvé la vraie foi, à moins qu’il y ait un juge infaillible de nos jugements.
Les réformateurs, forcés par cette attaque de se faire les défenseurs de la raison naturelle, affirment que nous avions une norme pour juger les inférences — les règles de la logique —, et aussi que Jésus et les Pères de l’Église raisonnent logiquement. Véron répond que les soi-disant règles de raisonnement ont été établies par un païen, Aristote ; pourquoi devrait-il être considéré comme le juge de la vérité religieuse ? Et ni Jésus ni aucun des Pères de l’Église n’ont soutenu que leurs vues étaient vraies à cause de la logique en cause ; mais elles le sont parce qu’elles sont la Parole de Dieu. Quand certains réformateurs répondent que c’est Zénon d’Élée, et non Aristote qui est l’auteur des règles d’inférence, Véron propose une objection : « Que ce soit Zénon ou un autre, sont-ils de meilleurs juges de nos controverses ? » Le chef calviniste Pierre du Moulin, dans ses Éléments de la logique française, s’oppose à cette logique qui n’est pas fondée sur les opinions de certains Grecs anciens, « car il y a une logique naturelle, que les hommes utilisent naturellement sans appliquer aucun art. Même les paysans font des syllogismes sans y penser. » À cela Véron s’exclame : « pauvre foi supposée, établie sur les règles de la logique de Zénon, ou sur la force de la raison paysanne ». Quelque chose d’aussi peu fiable que la raison naturelle d’un paysan peut difficilement donner une foi indubitable. Pourquoi ne pas accepter les décisions d’un conseil plutôt que celles d’un paysan ? Enfin, demande Véron, puisque l’on tire parfois de fausses conclusions, comment peut-on être tout à fait sûr, dans un cas donné, qu’on n’a pas commis d’erreur logique ?
Veron résume en huit « moyens » son argumentation contre le fait de dériver la vérité religieuse par le raisonnement à partir du texte biblique.
- Les conclusions auxquelles les réformateurs sont parvenus par déduction ne sont pas dans les Écritures.
- Ces inférences ne sont jamais effectuées dans les Écritures.
- En utilisant des inférences, la raison, plutôt que l’Écriture, se fait juge des vérités religieuses.
- La raison peut se tromper.
- L’Écriture ne dit pas que les conclusions tirées par des moyens logiques sont des articles de foi.
- Les pères de l’Église ne connaissaient pas les conclusions tirées par les réformateurs.
- Les conclusions, au mieux, ne sont que probables.
- Même une conclusion nécessairement vraie tirée des Écritures n’est pas un article de foi, car rien ne peut l’être sans avoir été révélé par Dieu.
Avec ce type d’argumentation, Véron essaye de créer un type particulier de crise sceptique pour ses opposants protestants. Contrairement au « scepticisme à l’égard de la raison » et au « scepticisme à l’égard des sens » que Montaigne et Charron avaient développés, Véron ne voulait présenter qu’un scepticisme à l’égard des usages du sens et de la raison en matière religieuse. À cet égard, il a essayé de montrer qu’une fois que les réformateurs ont nié l’existence d’un juge infaillible, ils ne sauraient avoir une foi garantie parce qu’ils n’ont aucune règle de foi défendable. Tous les critères de connaissance religieuse qu’ils ont adoptés – Écriture, persuasion intérieure, raison – s’avèrent douteux s’ils sont appliqués à des questions religieuses. Les calvinistes n’ont pas pu obtenir de certitude religieuse parce que toutes les normes qu’ils emploient risquent d’être sapées par le type de scepticisme que Véron propose.
[…]
Mais la « nouvelle machine de guerre » semble posséder un mécanisme de recul particulier qui a l’étrange effet d’engloutir la cible et le tireur dans une catastrophe commune, comme l’ont souligné les réformateurs. Si les arguments de Véron étaient acceptés, aucun travail écrit ne pourrait être correctement compris et compris. Nier que l’homme, aidé par ses facultés naturelles de raison et de sens, est juge de ce que quelque chose signifie aurait des conséquences dévastatrices, comme l’ont souligné les calvinistes Dailli, La Placette et Boullier, Glanvill l’anglican, Ferguson le non-conformiste, et comme le philosophe Leibniz le démontre. Non seulement le réformateur serait abandonné à lui-même pour déterminer quelle était sa foi, mais tout le monde le serait aussi. Le catholique qui fait appel aux Pères de l’Église serait confronté aux mêmes difficultés que celles que Véron avait soulevées. Comment savez-vous quels livres sont ceux des Pères de l’Église, comment savez-vous ce qu’ils disent ? L’appel à l’autorité papale se heurterait à une autre application de l’argument de Véron. Comment savoir qui est le pape, ce qu’il a dit, si on l’a bien compris ? Si le croyant possède des facultés faillibles, et qu’il ne peut pas leur faire confiance dans la lecture de l’Écriture, peut-il mieux leur faire confiance pour trouver le pape, pour l’entendre, pour l’interpréter ?
Le caractère de l’alliance entre les contre-réformateurs et les sceptiques en France est indiqué par le caractère autodestructeur de la « nouvelle machine de guerre ». L’alliance n’est pas seulement conclue à des fins stratégiques, comme Bredvold l’a suggéré. Elle touche aussi, pour beaucoup de contre-réformateurs français, le noyau idéologique de leur défense. Ils ne pouvaient pas être blessés par le bombardement sceptique parce qu’ils n’avaient aucune position à défendre. Leur foi n’était fondée sur aucune revendication rationnelle ou factuelle, mais sur une foi acceptée et incontestée dans la tradition catholique. Ils ont vu, comme l’avait affirmé Maldonat, que s’ils doutaient un jour de cette foi par acceptation traditionnelle, ils seraient détruits eux aussi, de la même manière que les réformateurs. C’est ainsi que l’on retrouve un fidéisme implicite chez de nombreux contre-réformateurs français, explicité dans les écrits des sceptiques français de Montaigne à La Mothe Le Vayer.
[…]
Après la mort de Montaigne, Charron révèle dans ses écrits l’ampleur réelle de son héritage, la magnifique union du scepticisme et du catholicisme… Il compose d’abord son opus théologique, Les Trois vérités, qui se veut d’abord un coup de canon contre les réformés et le calvinisme. Mais pour préparer le terrain et établir la première vérité, à savoir qu’il y a un Dieu, Charron propose un « Discours sur la connaissance de Dieu », dans lequel il lie le fidéisme de Montaigne à une des grandes traditions de la théologie chrétienne, celle des théologiens négatifs. Il soutient que la nature et l’existence de Dieu sont inconnaissables à cause de « notre faiblesse et de la grandeur de Dieu ». L’infinité de Dieu surpasse toute possibilité de connaissance, car connaître c’est définir, limiter, et Dieu est au-delà de toute limite. Ainsi, le plus grand philosophe et le théologien le plus averti ne connaissent pas Dieu plus ou moins que le plus humble des artisans. Mais la faiblesse et l’incapacité de l’homme est telle que même si Dieu n’était pas infini, nous ne pourrions pas encore le connaître. Charron y présente un bref résumé des raisons du scepticisme à l’égard de la connaissance humaine, puis déclara : « Ô chose pitoyable et vile que l’homme et toute sa sagesse sont ; ô présomption insensée et enragée d’essayer de connaître Dieu. »
[…]
Son œuvre suivante, La Sagesse, développe beaucoup plus longuement la faiblesse de l’homme et les conseils de Montaigne sur ce qu’il faut en faire. Ce traité, l’une des premières œuvres philosophiques écrites dans une langue moderne, ne contient guère plus que les vues de Montaigne présentées sous une forme organisée. L’une de ses caractéristiques uniques est la séparation de l’éthique et des considérations religieuses de Charron, peut-être pour la première fois dans la philosophie moderne.
[…]
Ce type de fidéisme atteint son apogée avec François de la Mothe Le Vayer, « le voluptueux incredule », qui a hérité du manteau de Montaigne de Mile, de Gournay. La Mothe Le Vayer s’élève au rang d’éminence sous le patronage de Richelieu et devient l’enseignant du frère du roi et membre de l’Académie française. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un esprit original, son scepticisme est probablement le plus profond de tous les montaigniens venus avant lui. Et malgré les attaques constantes contre sa religion ou son absence de religion, depuis ses contemporains comme Guez de Balzac et Antoine Arnauld jusqu’aux études les plus récentes de Pintard, Julien-Eymard d’Angers et Grenier, presque tous ses écrits incluent un appel constant et la défense d’un christianisme extrêmement fidéiste.
Le premier amour de La Mothe Le Vayer fut Sextus Empiricus, qu’il appela « notre maître », « le divin Sextus », « l’auteur de notre nouveau Décalogue », etc. Le thème sans fin des écrits de La Mothe Le Vayer, depuis ses premiers dialogues jusqu’à ses derniers soliloques, est que le pyrrhonisme est la philosophie la plus proche du christianisme, et que le message de saint Paul est vraiment le même que celui de Sextus. Le scepticisme nous enseigne la vanité et la présomption de toute tentative de comprendre la nature et Dieu, et le besoin de révélation. De plus, les vains espoirs des hommes dogmatiques de trouver des vérités sur la nature et Dieu, d’établir des sciences, sont véritablement impies. Si une science était possible, cela signifierait que Dieu était limité et mesurable selon les normes humaines en termes de sa nature et de sa création, et que Dieu n’est pas libre et tout-puissant. Le message des sceptiques est que l’homme ne peut et ne doit pas comprendre, et que ceux qui essaient de comprendre plongent vers l’hérésie et l’impiété. La seule connaissance que nous pouvons avoir est la révélation qu’il plaît à Dieu de nous donner. Le sceptique chrétien est le mieux à même de recevoir le Verbe divin parce que, comme Montaigne et Charron l’avaient affirmé, son esprit a été purgé d’erreurs et de présomptions. Mais supposons que le sceptique doute même de la Parole de Dieu ? S’il le fait, c’est son erreur catastrophique. Le pyrrhonisme devrait périr au pied de l’autel. Le sceptique ne doit pas porter ses doutes dans les affaires religieuses mais doit se soumettre à la révélation. Aucune enquête rationnelle n’aide ou n’encourage la découverte et la reconnaissance de la vérité divine. Tout ce que l’on peut faire, c’est de l’accepter par la foi, sans l’aide de preuves.
[…]
Cette alliance entre le pyrrhonisme et le catholicisme, telle que prônée par les disciples de Montaigne et employée par divers contre-réformateurs français, est, je crois, une idée qui sous-tend la Contre-Réforme en France. La stratégie qui consiste à combattre les calvinistes en détruisant leurs arguments par le scepticisme et en les réduisant au scepticisme complet est intelligible au regard de la théorie des fidéistes, tels Montaigne et Charron. Les polémistes catholiques ont développé une méthode sceptique pour détruire le calvinisme. Mais cette méthode détruirait toute théorie quelle qu’elle fût, malgré les restrictions suggérées par Veron. Par conséquent, la seule façon pour les catholiques d’éviter de se suicider intellectuellement tout en battant leurs adversaires était de ne pas avoir de théorie.
[…]
Cette alliance ingénieuse qui déroute les huguenots sur le plan idéologique, alors que la politique de Richelieu les réduit sur le plan politique, présente un écueil semblable à celle du pacte germano-soviétique. Son succès dépend de la sincérité des participants, de leur sincérité religieuse. Si le but des disciples de Montaigne n’est pas de sécuriser le catholicisme mais d’envelopper toutes les religions dans le doute pour que l’agnosticisme triomphe, alors l’alliance enlève aux catholiques les mêmes moyens de défense qu’ils ont déjà enlevés aux protestants. Avec l’influence croissante des sceptiques chrétiens au début du XVIIe siècle, et peut-être parce qu’ils les connaissaient trop bien, certains orthodoxes se sont demandé si la nouvelle base théologique, le pur fidéisme, pouvait vraiment être le libertinisme. Les premières suggestions que les catholiques avaient peut-être été trahis sont apparues dans les attaques sauvages des pères Garasse et Mersenne contre les sceptiques. Garasse, personnage pompeux du début du XVIIe siècle, a acquis beaucoup de notoriété pour ses attaques vicieuses contre Charron.
[…]
La prise de conscience que les défenseurs théoriques de la Contre-Réforme en France pouvaient réellement prôner la destruction de la religion s’est développée lentement. Même après que les avertissements ont été émis, plusieurs dirigeants catholiques ont continué à défendre l’alliance et à s’opposer aux théories alternatives à celles de la Contre-Réforme, comme celles de la Somme de Garasse et des Méditations de René Descartes qui avaient été proposées. Le danger que la défense du catholicisme offerte par les sceptiques ait fait du catholicisme un heureux accident en ce qui concerne les êtres humains semble avoir laissé indifférents nombre des contre-réformateurs français. Leur intérêt immédiat était la destruction intellectuelle du calvinisme ; si le prix nécessaire pour ce faire était d’envelopper tous les standards humains de preuve dans un scepticisme total, ils étaient prêts à le payer, puis à proclamer avec les disciples de Montaigne le bonheur qu’il y avait à constater que, quand on regarde sans idées reçues, Dieu nous a par bonheur révélé la foi catholique.
[…]
La tentative de mettre fin à l’alliance en prétendant que les sceptiques étaient secrètement des athées dont le but était de détruire toute religion, n’a guère eu de succès au début du XVIIe siècle. Les calvinistes assiégés qui ont donné des avertissements sur les conséquences de l’utilisation de la « machine de guerre » de François Véron ont également été ignorés. Les antisceptiques agressifs et prématurés, comme Garasse et Descartes, se trouvent dénoncés et persécutés par les dirigeants les plus orthodoxes de la société, tandis que les « sceptiques chrétiens » prospèrent comme favoris de Louis XIV et dominent la scène intellectuelle. Garasse est condamné par la Sorbonne et réduit au silence par l’ordre des Jésuites. Descartes, offrant une théorie positive pour démontrer l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme, pour remplacer le scepticisme et le fidéisme contemporains, se trouve attaqué par un jésuite de premier plan, le père Bourdin, et assailli par l’ordre jésuite jusqu’à ce que ses œuvres soient condamnées à la fin du siècle. Parmi les chefs de file de la lutte contre le cartésianisme se trouvaient le père Gabriel Daniel, jésuite qui préférait le scepticisme de Gassendi à la métaphysique dogmatique de Descartes, et Pierre-Daniel Huet, évêque d’Avranches, et successeur de La Mothe Le Vayer comme chef du Dauphin, qui préconisait un pyrrhonisme chrétien complet, de préférence au dogmatisme hérétique de Descartes pour essayer d’asseoir une base rationnelle à la religion.
[…]
L’alliance est morte à la fin du XVIIe siècle, les sceptiques étant désormais considérés comme des ennemis de l’Église plutôt que comme des amis. Il est difficile de dater sa fin, et la volte-face dans l’évaluation des mérites et des objectifs des sceptiques chrétiens. Mais le sort de l’Histoire critique du Vieux Testament de 1678 du père Richard Simon, couronnement de la « nouvelle machine de guerre », est probablement révélateur de ce qui se passait. Cet ouvrage savant prétend démolir l’appel calviniste à l’Écriture en montrant que (a) aucun manuscrit original de la Bible n’existe, et (b) personne ne connaît la signification originale de l’hébreu ancien. C’est pourquoi le père Simon a prétendu que personne ne pouvait fonder sa foi sur les Écritures.
Les potentialités destructrices de l’œuvre de Simon ont été immédiatement comprises, ainsi que les implications qu’elle avait pour tous les documents historiques, qu’ils fussent scripturaires, apostoliques, papaux ou autres. L’œuvre, dédiée à Louis XIV, a été mise au pilon avant sa publication. (Une copie de cette édition est conservée dans la bibliothèque du dernier grand leader de l’alliance, le dernier disciple en ligne directe de Montaigne, Mgr Pierre Daniel Huet.)
L’alliance dure à peu près de la fin du concile de Trente jusqu’à la révocation de l’Edit de Nantes, jusqu’à ce que la France soit à nouveau « toute catholique ». Mais la France « toute catholique » était sur le point de montrer un des effets d’un siècle de scepticisme en matière de foi, dans les Lumières, dans l’application de cette tradition au christianisme même par Voltaire, Diderot, et d’autres.
L’alliance contenait un problème intellectuel qui devait être à l’origine de sa destruction. Le scepticisme total à l’égard de tout fondement de toute connaissance humaine a éliminé la possibilité de toute base rationnelle pour la religion aussi. Le scepticisme total n’implique aucune conclusion quant à ce que l’on doit croire. Si le « sceptique chrétien », ou l’opérateur de la « machine de guerre » ont des croyances, c’est accidentel en ce qui concerne son argument négatif. Si l’on accepte l’argument négatif, le doute sur la possibilité que l’homme, par des moyens rationnels, trouve jamais la vérité, alors sur quelle base les membres de l’alliance peuvent-ils défendre leur foi ? Aucune croyance n’est compatible avec leur argument, ou toute croyance l’est, puisque leur argument n’implique rien du tout. On pourrait accepter les raisonnements négatifs de Charron et de Véron si l’on était complètement agnostique, ou si l’on était catholique, protestant, ou autre…
[…]
Le fondement théorique de cet aspect de la Contre-Réforme française est comme une épée à deux tranchants, qui peut être utilisée contre tout argument en faveur du catholicisme comme contre tout argument en faveur du calvinisme. Si ceux qui emploient l’épée ne sont pas des croyants, le résultat peut être un autre âge des Lumières au lieu d’un autre âge de foi. L’appel actuel au scepticisme chrétien dans le mouvement néo-orthodoxe pourrait bientôt donner naissance à un nouvel héritier non désiré, une nouvelle époque voltairienne.
Illustration : Sebastiano Ricci, Paul III inspiré par la Foi pour convoquer le concile de Trente, huile sur toile, 1687 (Rome, Palais Farnèse).



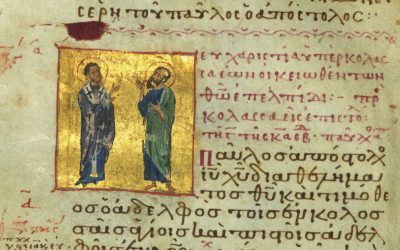
0 commentaires
Trackbacks/Pingbacks