Voici un extrait d’un livre Les travers de la zététique : Réponse au livre « Dieu, la contre-enquête (pp. 25-28) de notre ami Matthieu Lavagna, jeune apologète catholique, où il démonte l’épistémologie des zététiciens dont un principal représentant est Thomas Durand avec son livre Dieu, la contre-enquête, apparemment à la mode chez les zététiciens (un courant prétendant promouvoir l’esprit critique). Les zététiciens ont tendance à tomber dans le scientisme qui prétend que la science physico-mathématique, donc science au sens moderne, est le seul moyen fiable pour acquérir des connaissances objectives, accordent une trop grande place au doute et ont une trop grande exigence en cherchant absolument à connaître avec certitude les choses.
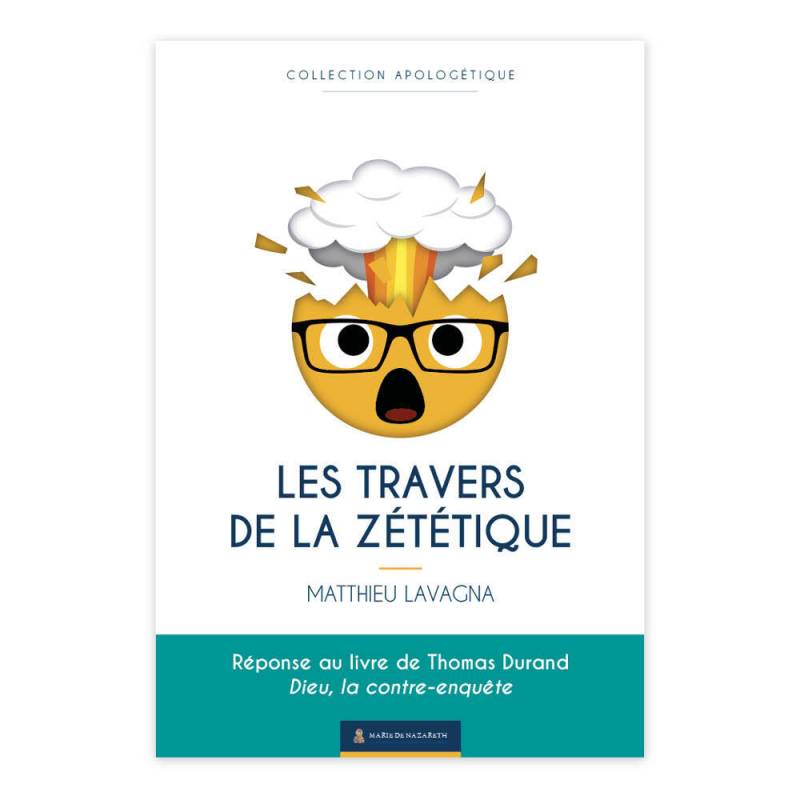
Ayant répondu aux attaques psychologisantes de Thomas Durand, il nous semble à présent important de répondre à ses positions épistémologiques1. Lui-même se revendique membre de la mouvance zététique. Mais qu’est-ce que la zététique, au juste ? D’après le site officiel de cette discipline, la zététique serait « synonyme de “pensée critique”, ou de “scepticisme méthodologique” » et promeut « l’art du doute ». Pour le dire simplement, il s’agit de douter systématiquement de tout et de refuser toute forme de certitude.
L’ultra-scepticisme par principe : le doute méthodique
Ce doute systématique se caractérise par un ultra-scepticisme de principe. D’ailleurs Thomas Durand ne se cache pas d’être un « sceptique », c’est-à-dire quelqu’un qui n’affirme rien tant qu’il n’a pas de preuves :
Je plaide pour la démarche sceptique, celle qui nous prévient qu’il est présomptueux et téméraire d’accepter de croire ce qui n’est pas étayé avec de bons arguments.
Thomas Durand, op. cit., p. 14.
Il va même jusqu’à affirmer :
D’un certain point de vue extrêmement sceptique, on peut considérer qu’il n’est pas possible de prouver que le monde existe réellement. On peut imaginer que l’univers n’est rien d’autre qu’un décor fictif, une sorte de matrice. On peut imaginer que rien n’existe, que l’univers soit mental…
Ibid., p. 347.
L’auteur nous présente ainsi son épistémologie du doute méthodique ainsi :
Pour atteindre une relative certitude de la véracité de X, on doit commencer par douter de X.
Ibid., p. 47.
Or, cette affirmation est indubitablement fausse. Par exemple, nous n’avons pas à douter des lois de la logique ou des vérités mathématiques, comme 1 + 1 = 2, avant de pouvoir en être certains. Nous n’avons pas non plus à douter du fait qu’il soit immoral de torturer un bébé pour le plaisir avant d’en avoir la certitude. Thomas Durand pense-t-il vraiment qu’il faille nécessairement douter de l’amour de nos propres parents à notre égard avant de pouvoir être certains qu’ils nous aiment ? Nous pensons qu’un tel scepticisme radical est infondé et impossible à vivre en pratique.
À partir du moment où l’on doute de tout, il n’y a plus aucun moyen de vivre normalement et de construire une pensée solide, car son fondement peut toujours être remis en question. Pour sortir de cette impasse, il faut donc nécessairement admettre qu’à la base de la connaissance, il existe des évidences données par la lumière naturelle de la raison.
Une profession de foi scientiste en contradiction avec le monde réel
Thomas Durand ne cache pas non plus son présupposé scientiste :
La méthode scientifique est la seule démarche dont nous disposons pour produire une connaissance objective, c’est-à-dire une connaissance qui reste vraie quelle que soit la culture, l’époque, l’humeur ou l’idéologie de l’individu. […] Les théories scientifiques constituent par conséquent le nec plus ultra de la connaissance objective.
Ibid., pp. 38-39.
Le comble est que cette affirmation est contradictoire en elle-même. En effet, « la méthode scientifique est la seule démarche dont nous disposons pour produire une connaissance objective » est une affirmation de type… philosophique ! Aucune méthode scientifique ne pourra jamais vérifier cette affirmation. Par conséquent, l’assertion de Thomas Durand est auto-réfutée. Elle implique logiquement sa propre fausseté.
De plus, il existe beaucoup de domaines de connaissances qui sont intrinsèquement inaccessibles à la science :
- Les vérités mathématiques et les lois de la logique ne peuvent pas être prouvées par les sciences expérimentales. Celles-ci les présupposent pour fonctionner.
- Les vérités métaphysiques, comme l’impossibilité qu’un être soit cause de lui-même ou le fait que le néant n’ait pas de pouvoir causal, sont des vérités non démontrables par la science.
- Les vérités éthiques sur la valeur de la vie humaine ne peuvent pas être prouvées par la science (la science ne pourra pas vous dire s’il était moralement bon ou mauvais de faire des expériences sur les Juifs dans les camps de concentration ; seule la philosophie morale peut le faire).
- Les vérités esthétiques et la notion de « beauté » ne peuvent pas être vérifiées scientifiquement (la science ne pourra jamais vous dire si telle œuvre d’art est belle ou si un coucher de soleil est beau).
- Enfin, la science elle-même présuppose certaines vérités pour pouvoir fonctionner, comme la réalité du monde extérieur, la constante application de lois de la physique, etc.
Par conséquent, l’affirmation de Thomas Durand est indubitablement fausse. Nous ne pouvons pas restreindre nos connaissances objectives aux théories scientifiques2.
Quelle autre source ?
Car si l’on considère que les sciences n’ont rien à dire [sur le réel], alors quelle autre source se verra autorisée ? Quelle autre méthode sera employée ?
Ibid., p. 261.
Personne ne soutient que la science empirique n’a rien à nous dire sur le réel. Nous affirmons simplement que la science empirique n’est pas la seule à pouvoir y porter un regard objectif. La philosophie, l’histoire et bien d’autres disciplines nous permettent d’accéder à des connaissances pour comprendre le monde3.
Thomas Durand commet aussi une confusion épistémologique sur la nature de la philosophie :
L’éthique et la philosophie traitent du bien et du mal. La science est apte à répondre aux questions du vrai et du faux.
Ibid., p. 41.
Cette affirmation sous-entend que la philosophie et l’éthique ne pourraient pas traiter du vrai et du faux. Or, c’est tout le contraire ! Par exemple, on peut dire que l’affirmation : « il est immoral de tuer un enfant de deux ans » est vraie, bien qu’elle ne soit pas scientifique à proprement parler. De plus, dire que seule la science est capable d’émettre des affirmations vraies est une contradiction en soi puisque, encore une fois, il ne s’agit pas d’une affirmation scientifique, mais philosophique.
Thomas Durand poursuit :
Ce que nous savons grâce à la science, nous savons pourquoi nous le savons.
Ibid., p. 43.
Certes, il est vrai que nous pouvons savoir pourquoi la plupart de nos connaissances scientifiques sont vraies. Mais pourquoi n’en irait-il pas de même avec l’histoire, la philosophie ou la métaphysique ? En histoire, par exemple, nous savons pourquoi il est vrai que saint Paul s’est converti au christianisme. Nous le savons grâce à ses lettres où il en témoigne lui-même à maintes reprises. En métaphysique, nous savons pourquoi la proposition « de rien ne sort rien » est vraie. Elle est vraie, tout simplement parce que le néant n’a pas de pouvoir causal. La non-existence de quoi que ce soit ne saurait produire l’existence de quelque chose. De même, nous savons pourquoi il est impossible qu’un être soit cause de lui-même, etc.4 Pourtant, toutes ces vérités ne sont pas scientifiques à proprement parler. Par conséquent, il est manifeste que la science n’est pas le seul domaine où nous savons pourquoi nos connaissances sont vraies.
Ajoutons que ce que nous savons à travers la science, nous le savons parce que nous constatons que le monde est intelligible et qu’il dépend de lois physiques régulières. Mais la science est incapable de nous dire pourquoi le monde est intelligible et pourquoi ces lois physiques sont régulières et s’appliquent universellement. Il s’agit là d’un présupposé philosophique qui sert de base à nos connaissances scientifiques.
Négation de la vérité absolue
D’après Thomas Durand, « il est prudent de ne jamais prétendre posséder une vérité absolue sur quelque sujet que ce soit » (p. 58).
Cette affirmation est indubitablement fausse. Tout d’abord, si quelqu’un disait qu’il n’y a pas de vérité absolue, ce serait une contradiction en soi, car cette affirmation se doit d’être une vérité absolue pour pouvoir exclure les vérités absolues. De plus, nous connaissons un bon nombre de vérités absolues : les théorèmes mathématiques, les lois de la logique (principe de non-contradiction, loi de contraposition, etc.). Nous avons aussi accès à certaines vérités absolues en métaphysique (par exemple, les propositions « j’existe » ou « il existe quelque chose »), ainsi qu’en matière morale (il est absolument vrai que torturer un bébé pour le plaisir est immoral, etc.).
Un mot sur le scepticisme en général
Thomas Durand affirme :
Le scepticisme nous prévient de nos erreurs de perception, des biais de nos jugements, des imperfections de notre grille d’interprétation, ce qui nous amène à favoriser tous les moyens qui peuvent corriger notre raisonnement. Le sceptique se méfie de ses certitudes, il les met à l’épreuve, il cherche autour de lui des éléments de preuve. […] L’adhésion au surnaturel emprunte généralement un autre chemin, au long duquel la vérité intérieure est prééminente.
Ibid., p. 284.
Ici, nous dirons qu’il existe un bon scepticisme et un mauvais scepticisme :
- Le bon scepticisme s’interdit de tout croire sur parole et cherche de bonnes raisons de croire dans la limite du raisonnable5.
- Le mauvais scepticisme, au contraire, doute d’absolument tout. Il rejette toute forme de certitude en général6.
C’est précisément contre cette deuxième forme de scepticisme que nous devons lutter. Il n’y a aucune raison de se méfier des certitudes de manière générale, si les raisons de les entretenir sont solides. Nous avons un bon nombre de certitudes qu’il serait parfaitement irrationnel de remettre en question et Thomas Durand serait sûrement prêt à le reconnaître :
- Les certitudes7 d’ordre mathématique et logique : « A => B ⬄ non(B) => non(A) ; 1 + 1 = 2 ; « Le théorème de Pythagore est vrai. »
- Les certitudes métaphysiques : « J’existe » ; « Il existe quelque chose » ; « Le mouvement est un phénomène réel » ; « Un être ne peut pas être simultanément antérieur et postérieur à lui- même » ; « Le non-être ne peut pas produire de l’être ».
- Les certitudes d’ordre relationnel : « Mes parents m’aiment » ; « Je suis amoureux ».
- Les certitudes d’ordre moral : « Il est immoral de violer un enfant » ; « Le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale était immoral ».
- Les certitudes historiques : « Napoléon a existé » ; « Paul de Tarse s’est converti au christianisme » ; « Les premiers chrétiens ont cru à la résurrection » ; « Le concile de Nicée a eu lieu en 325 » ; « Constantin a été le premier empereur chrétien ».
- Les certitudes scientifiques : « La Terre tourne autour du Soleil » ; « L’Univers est en expansion » ; « Les plantes ont besoin d’eau et de soleil pour grandir ».
Toutes les propositions ci-dessus sont certaines, bien que leurs modes d’acquisition soient différents. Notre intellect les affirme sans aucune crainte de se tromper. Il n’y a pas à « se méfier » de ces certitudes, contrairement à ce qu’affirme Thomas Durand.
L’importance du témoignage humain
Il est nécessaire de rappeler qu’une grande partie de nos connaissances (y compris nos certitudes historiques et scientifiques) sont fondées sur le témoignage humain. Par exemple, comment savez- vous votre date de naissance ? Eh bien, tout simplement parce que des personnes en qui vous avez confiance (souvent les parents) vous l’ont dit. Vous n’avez aucun moyen de le vérifier vous-même. Il vous faut avoir « foi » en la parole de vos parents et de ceux qui se sont occupés de votre dossier de naissance. Comment savez-vous que le grand théorème de Fermat est vrai8? À moins d’être un mathématicien de très haut niveau, vous le savez parce que les meilleurs mathématiciens de la planète vous confirment que c’est le cas. Et ainsi de suite pour la quasi-totalité de nos connaissances.
On comprend alors ce principe fondamental de l’épistémologie du témoignage : à moins d’avoir des raisons particulières (circonstancielles) de penser que le témoignage humain n’est pas fiable, nous devons supposer qu’il l’est a priori. Autrement dit, nous devons considérer les propos d’autrui comme dignes de foi, à moins d’avoir des raisons spécifiques d’en douter9.
Or si l’on appliquait le scepticisme extrémiste de la zététique (à savoir, « il faut se méfier des certitudes »), il faudrait toujours commencer par douter du témoignage qui nous est donné par principe, sauf si vous avez des preuves qu’il est fiable. Cela aboutirait à l’écroulement de la quasi-totalité de nos connaissances, au point de rendre la vie simplement impossible à vivre, tant la confiance est au cœur de nos connaissances quotidiennes. L’épistémologie zététicienne impliquerait qu’il faille douter de la fiabilité de la parole du médecin lorsqu’il vous annonce que vous avez un cancer, du professeur de physique lorsqu’il affirme que les atomes sont constitués de protons, de neutrons et d’électrons, ou encore de l’horaire de départ du train sur le billet que vous venez d’acheter. Or, cela est absurde. Toutes ces connaissances sont acquises par le biais de témoignages de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Il est donc parfaitement possible d’avoir des connaissances ou certitudes réellement fondées uniquement sur la base du témoignage humain.
Un mélange des genres et une confusion épistémologique sur la notion de « dogme »
Thomas Durand se plaint du fait que la religion ne donne aucune information intéressante sur la science. Il s’attriste de ce que les dogmes ne contribuent pas à nos connaissances scientifiques :
On n’a jamais vu une personne tirer de sa religion de véritables preuves qu’une théorie scientifique est fausse. […] Aucune croyance religieuse n’a jamais reposé sur l’examen critique des dogmes établissant la vérité sur l’univers, mais au contraire sur l’effort continuel de mieux contempler le dogme par des opérations d’exégèse afin de conforter une vision du monde ou d’y retrouver des vérités déjà découvertes par d’autres moyens.
Ibid., p. 40.
Nous répondrons à Thomas Durand qu’il mélange les disciplines et leurs vocations respectives. Le rôle de la religion n’est pas de nous apporter des connaissances sur la physique, mais de nous apprendre des choses sur Dieu et sur notre relation à lui dans la perspective du salut. Dieu n’a aucun intérêt à nous apprendre la taille de l’atome d’hydrogène ou la masse du Soleil. Cela ne sert à rien au salut de notre âme. Par conséquent, ce n’est pas à la religion de nous apporter « de véritables preuves qu’une théorie scientifique est [vraie ou] fausse ». Il est donc parfaitement vain de réaliser un « examen critique des dogmes » en vue d’établir « la vérité sur l’univers ». Ce serait comme vouloir établir un examen critique de la beauté d’une œuvre d’art en vue d’établir la vérité sur les propriétés chimiques qui la constituent. Une telle entreprise est absurde dès le départ et mélange les vocations respectives des disciplines de l’esthétique et de la chimie.
D’après Thomas Durand, « on ne devient presque jamais croyant à la suite d’une démonstration logique de la validité scientifique des contenus d’un dogme » (p. 45). Son affirmation n’a malheureusement aucun sens et démontre qu’il a de profondes lacunes en épistémologie. En effet, la science, par nature, ne peut pas évaluer la validité ou la fausseté d’un dogme, tout simplement parce que cela ne relève pas de son domaine d’étude. Il est absurde de soutenir que la science soit en mesure de confirmer ou d’infirmer des dogmes comme l’Incarnation, la Trinité ou l’Immaculée Conception. En effet, les dogmes religieux n’affirment rien sur les lois physiques10. Il serait donc aberrant de soutenir que la science empirique puisse, en tant que telle, réussir à prouver (ou à réfuter) un dogme11.
Profession de foi vérificationniste et positivisme logique
Thomas Durand poursuit par une profession de foi vérificationniste12 où il prétend qu’une affirmation doit pouvoir être « testée » pour rester dans le domaine de la pensée rationnelle :
Une affirmation irréfutable est un énoncé ni faux ni vrai, et qui, ne pouvant être testé, sort ipso facto du domaine de la pensée rationnelle pour devenir une opinion, un sentiment ou une conviction.
Ibid., p. 48.
Mais notre zététicien ne se rend pas compte que ses propres affirmations sont auto-réfutatives. L’affirmation qu’il vient d’émettre peut-elle être testée ? Non. En conséquence, et d’après son propre critère, elle devrait sortir « ipso facto du domaine de la pensée rationnelle ». Si l’on avait besoin de « tester » les affirmations avant de pouvoir les intégrer dans le domaine de la pensée rationnelle, alors on ne pourrait pas savoir si le principe de non-contradiction ou si les lois de la logique sont vraies, car ces dernières ne peuvent pas être « testées ».
De même, les vérités morales n’ont pas besoin d’être testées pour être connues avec certitude. Par exemple, la proposition « il est immoral de réduire les personnes noires en esclavage » est une vérité qui n’a pas besoin d’être « testée » pour être avérée. On peut savoir qu’elle est vraie de manière conceptuelle, en se fondant sur la notion de dignité humaine et d’égalité intrinsèque entre les races. Ainsi, la thèse « vérificationniste » de Thomas Durand aboutit à l’exclusion de toutes les vérités conceptuelles (logiques, mathématiques, morales et philosophiques), puisque celles-ci ne sauraient être « testées ». Une telle épistémologie mène inéluctablement à un véritable suicide de la raison.
Le délicat usage des « vérités » métaphysiques
Thomas Durand aborde aussi ce qu’il nomme le « délicat usage des “vérités” métaphysiques13 », en titre de son chapitre 5. Le mot « vérité » y figure entre guillemets, comme si la métaphysique ne pouvait rien dire d’absolument vrai ; comme si la science, elle, pouvait atteindre la vérité, mais que la métaphysique en était incapable. Ce serait à nouveau commettre une grave erreur, puisque la science repose quasi intégralement sur la vérité des principes métaphysiques (principe de causalité, principe de raison suffisante, etc.). Sans ces principes inébranlables de la métaphysique, la science tout entière s’écroule. Elle devient incapable d’expérimenter quoi que ce soit. C’est pourquoi, dans l’ordre du savoir, la métaphysique nous donne des connaissances encore plus certaines que la science.
Thomas Durand reprend malheureusement son épistémologie vérificationniste pour pouvoir l’appliquer à l’Univers : « Si nous voulons établir des connaissances objectives sur l’univers, nous devons être capables de produire des hypothèses et de les tester. » Cette affirmation est fausse. Je peux savoir objectivement que, dans notre Univers, tout ce qui a commencé d’exister a une cause, sans avoir pu le « tester ». Je le sais par une analyse conceptuelle et métaphysique, du fait que le non-être ne peut pas produire de l’être.
Illustration : Allan Ramsay, Portrait de David Hume, huile sur toile, 1766.
- L’épistémologie est la discipline qui étudie la nature de nos connaissances.[↩]
- On notera une autre erreur de type scientiste dans le livre (p. 180), où Thomas Durand affirme que « la science a, en quelque sorte, résolu la question de la théodicée […] », chose absolument impossible, puisque la notion de « théodicée » est philosophique. Elle ne saurait donc se résoudre scientifiquement.[↩]
- Si Dieu existe et s’il s’est révélé à l’homme, alors il est possible que la théologie soit aussi une discipline qui nous aide à comprendre le monde. Du moins, nous ne pouvons pas exclure cette possibilité a priori, à moins de démontrer l’inexistence de Dieu ou de montrer qu’il ne s’est pas révélé.[↩]
- Pour se causer soi-même, il faudrait se précéder soi-même dans l’existence, c’est-à-dire exister avant d’exister, ce qui est impossible.[↩]
- Sous ce rapport-là, il est parfaitement compatible d’être chrétien et sceptique simultanément ![↩]
- Ce faisant, le mauvais scepticisme devient paradoxal : si l’on doit douter de tout, alors il faut aussi douter du fait qu’on doive douter de tout ![↩]
- Par « certitude », il faut entendre ici « l’adhésion ferme de l’intellect à une proposition sans aucune crainte de se tromper ». Voir Abbé Bernard Lucien, Apologétique – La crédibilité de la Révélation divine transmise aux hommes par Jésus- Christ, Nuntiavit, 2011, pp. 185-192, pour un exposé sur les différents types de « certitudes ».[↩]
- Le grand théorème de Fermat a été démontré par le mathématicien Andrew Wiles en 1994. Il affirme ceci : pour tous réels strictement positifs x, y et z quel que soit l’entier n > 2, x + yn n’est jamais égal à zn.[↩]
- Richard Swinburne, Y a-t-il un Dieu ?, Ithaque, 2009, p. 124.[↩]
- Ils peuvent, en revanche, affirmer que certaines choses arrivent en dehors des lois de la physique.[↩]
- À la limite, on pourrait tenter de réfuter les dogmes conceptuellement (par exemple, en essayant de trouver une contradiction conceptuelle interne à la Trinité), mais on ne saurait affirmer que la science est en mesure d’infirmer (ou de confirmer) ces doctrines.[↩]
- Le positivisme logique est une thèse épistémologique née dans les années 1920 élaborée par le cercle de Vienne, un groupe réunissant des scientifiques et philosophes viennois influencés par le physicien allemand Moritz Schlick. Il est fondé sur le critère de vérifiabilité qui soutient qu’un énoncé n’a de signification cognitive que s’il est vérifiable par l’expérience.[↩]
- La métaphysique est « l’étude de l’être en tant qu’il est ». Il s’agit d’une sous-branche de la philosophie, qui porte sur la recherche des causes les plus profondes de la réalité et qui étudie les principes premiers (causalité, téléologie, etc.).[↩]




0 commentaires