La question de « Comment être chrétien dans un monde déchristianisé » nous agite tous à différents niveaux. Et il y a une quantité de livres qui cherchent à y répondre, mais peu ont eu le rayonnement et l’influence du livre de Stanley Hauerwas et de William H. Willimon : Étrangers dans la cité, publié une première fois en 1989, traduit en français en 2016. Les auteurs proposent d’abandonner l’évangile social du libéralisme méthodiste pour quelque chose de plus post-moderne et axé davantage sur l’aspect narratif de l’Église, plutôt que son engagement sociétal. Il m’a été personnellement recommandé par Pep’s, dont je vous encourage à lire l’autre recension. Considérant qu’il cadre pas mal avec mon cycle de lectures du moment, je propose ici une recension détaillée, contenant à la fois le discours et ma réception de celui-ci.
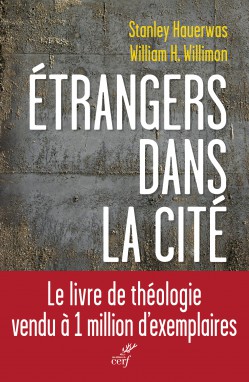

Chapitre 1 – Le monde moderne : apprendre à poser les bonnes questions
Un monde changé
Ils constatent la fin de la chrétienté, illustrée par l’ouverture le dimanche du cinéma de Greenville, Caroline du Sud, en 1963. Ils interprètent cet évènement comme une libération du constantinisme (vaguement compris comme « culture chrétienne majoritaire »).
Justes questions théologiques
Longtemps la question a été : comment rendre l’Évangile crédible pour le monde moderne ? Les auteurs éreintent alors Tillich et les gens qui réinterprètent le christianisme en le vidant de sa substance et exprimant d’autres religions par des mots chrétiens. Hauerwas et Willimon sont plutôt disciples de Karl Barth qu’ils admirent. Le souci de cette question, selon eux, c’est qu’elle part du principe que le christianisme doit être intellectuellement crédible pour que l’on puisse ensuite bâtir une civilisation dessus. Or, ils pensent que le christianisme n’est pas doctrinal pour commencer :
Nous croyons que le Christianisme n’a rien à gagner d’une défense utilitarienne de la croyance en tant que croyance. Le présupposé théologique (que nous attribuerons probablement faussement à nos premiers théologiens apologètes – certains des Pères primitifs) que le Christianisme est un système de croyance doit être questionné. C’est le contenu de la croyance [belief] qui concerne l’Écriture, pas d’éradiquer l’incroyance par le moyen d’un système théologique crédible. La Bible trouve inintéressante nos préoccupations modernes de savoir si oui ou non il est toujours possible aux personnes de croire. Le souci de la Bible est de savoir si oui ou non nous sommes fidèles à l’évangile, la vérité sur les choses d’aujourd’hui est que Dieu est avec nous à travers la vie, la croix et la résurrection de Jésus de Nazareth.
Hauerwas Stanley et Willimon William H., Resident Aliens: Life in the Christian Colony, Nashville : Abingdon Press, 1989, p 9.
Bref, la démarche est plus éthique que métaphysique.
Nouvelle compréhension ou nouvelle vie ?
Le défi est donc de développer une éthique collective en alignement avec Christ.
À noter qu’ils utilisent le mot « politique » pour deux concepts différents : 1. La politique proprement dite, c’est-à-dire la gestion des affaires collectives et 2. La partisanerie, c’est à dire les questions de partis, factions, élections, programme, etc. En gros, ils rejettent les alignements partisans, même à gauche, parce que la démarche éthique qu’ils proposent reste de la partisanerie, et n’est pas le domaine de l’Église :
Ce qui rend l’église radicale et toujours nouvelle n’est pas que l’église penche à gauche sur la plupart des questions sociales, mais plutôt que l’église connaisse Jésus alors que le monde ne le fait pas. Au regard de l’Église, la gauche politique n’est pas plus intéressante que la droite politique ; les deux côté tendent vers des solutions qui se déroulent comme si le monde n’avait pas fini et commencé en Jésus. Ces solutions ne sont que des reflets du statu quo.
Ibid, p. 13
Or, la fin de la chrétienté est une opportunité pour redéfinir les relations entre Église et Monde.
Ma réaction
Il est important de comprendre que le contexte dans lequel Hauerwas et Willimon écrivent ce livre est celui de l’Église Méthodiste Unie. Elle fait partie des églises dites mainstream aux États-Unis, c’est-à-dire libérales. Elle traverse actuellement un schisme où l’église américaine pousse les opposants à l’homosexualité en dehors de l’Union, au niveau mondial (elle est aussi présente en Afrique). Ce que propose Hauerwas est donc à destination des libéraux.
Du reste, il est possible aussi de voir cela dans le choix des auteurs sur lesquels ils s’appuient : Karl Barth qui en son temps a proposé une réforme du libéralisme que l’on appelle « la néo-orthodoxie », et John Howard Yoder, un théologien mennonite (mais aux méthodes d’interprétations libérales), célèbre pour sa défense du pacifisme chrétien qui a beaucoup influencé les auteurs d’une part, et les scandales sexuels qui ont surgi à sa mort d’autre part.
Je dis cela comme un contexte, afin de mieux interpréter le texte. Cela permet d’expliquer pourquoi les auteurs méprisent tout de suite la doctrine et la métaphysique, pour redéfinir l’Évangile comme prioritairement éthique. C’est une position libérale classique depuis la fin du XVIIIe siècle.
On comprend ainsi la prose parfois plus poétique qu’utile. Quelqu’un pourrait-il m’aider à comprendre la phrase : « La tâche du théologien n’est pas de rendre l’évangile crédible pour le monde moderne, mais le monde crédible à l’évangile. » (p.10) ? C’est réellement balancé ainsi, sans explication, comme si c’était auto-évident.
Chapitre 2 – La politique chrétienne dans le Monde Nouveau
Thèse : Le christianisme est surtout une affaire de politique telle que définie par l’Évangile. Ce qui signifie : rejoindre la communauté alternative de l’Église pour développer une contre-culture.
Ayant mis en doute la notion que le Christianisme soit fondamentalement un corps de croyances, dans ce chapitre nous voulons défendre que le Christianisme est une affaire de politique – la politique définie par l’évangile. L’appel à faire partie de l’évangile est un appel joyeux à être adopté par un peuple étranger, joindre un phénomène contre-culturel, une nouvelle polis appelée l’Église. Le défi de l’Évangile n’est pas un dilemme intellectuel sur comment rendre un système de croyances archaïque compatible avec les systèmes de croyances modernes. Le défi de Jésus est le dilemme politique de comment être fidèle à une communauté étrangère, façonnée par l’histoire de comment Dieu vit parmi nous. Dans ce chapitre, nous allons mettre à l’épreuve cette présupposition, si prévalente depuis Constantin, que l’Église doit être jugée politiquement par comment la présence de l’Église dans le monde est à l’avantage ou au détriment du monde.
Ibid, p.15
Mélanger religion et politique
Dans les années 1960, Reinhold Niebuhr avait critiqué l’Église d’être trop passive en politique (partisane). Aux yeux de Hauerwas et Willimon, ce n’est que du constantinisme de gauche : utiliser l’Église comme un agent politique et culturel ordinaire.
Politique de l’incroyance
Ensuite, les auteurs se tournent vers une campagne de promotion du National Council of Churches1 : il s’agissait d’une terre portée par des mains de toutes couleurs avec comme slogan « la Justice et la Paix ». Après avoir ironisé sur l’iconographie2 ils font remarquer que le problème c’est que dans cette campagne, Dieu est complètement superflu, c’est de l’athéisme politique3 : l’Église n’agit pas ici de façon proprement chrétienne. Sa tâche n’est pas d’influencer le monde de manière à ce que l’extérieur soit en conformité avec des gentilles valeurs chrétienne. La tâche de l’Église est de fournir la définition même des mots de manière à ce que tout soit captif à Christ :
Nous défendons que la tâche politique des chrétiens est d’être l’Église plutôt que transformer le monde. Une raison pour laquelle ce n’est pas assez de dire que nous devons rendre le monde meilleur, c’est que nous les chrétiens n’avons pas d’autre moyens de comprendre correctement le monde et interpréter justement le monde, sinon par l’Église. Des grands mots comme « paix » et « justice » sont sans contenus, alors que l’Église les adoptent sous la présupposition que les gens qui ne savent que ce que « Jésus Christ est Seigneur » veut dire, sauront ce que « paix » et « justice » signifient. L’Église ne sait vraiment pas ce que ces mots signifient sans la vie et la mort de Jésus de Nazareth.
Ibid, p.20-21
Ce qui est étrange, c’est que tout « constantinien » que je sois, je suis d’accord avec ces mots. Mais comment Hauerwas et Willimon pourraient-il imposer la définition chrétienne de « Justice » et « Paix » si l’Église ne capture pas le système éducatif d’une nation ? Et comment le capturerait-elle, si l’État ne lui donne pas ? Or ces deux choses seraient justement le constantinisme qu’ils rejettent !
L’Église en tant que stratégie sociale
Rejetant Reinhold Niebuhr, Hauerwas et Willimon s’appuient plutôt sur John Howard Yoder pour reprendre la distinction suivante4
- Église Activiste : correspond aux églises libérales adeptes de l’évangile social, comme l’Église Méthodiste Unie : l’Église est avant tout là pour agir au niveau partisan et sociétal.
- Église Conversionniste : correspond aux églises fondamentalistes. L’Église n’existe que pour amener des gens à l’expérience de conversion.
- Église confessante5 : l’Église existe avant tout pour « louer Dieu en toutes circonstances ».
Dans la suite, cette Église confessante semble avoir l’emphase spirituelle de l’église conversionniste, mais avec une dimension collective :
L’Église confessante n’est pas une synthèse de deux autres approches[…]. Au lieu de ça, c’est une alternative radicale. Rejetant à la fois l’individualisme des conversionnistes et le sécularisme des activistes […] l’église confessante trouve sa principale tâche politique non pas dans la transformation personnelle des cœurs individuels ou la modification de la société, mais plutôt dans la détermination de l’assemblée à louer Christ en toutes choses.
Ibid, p.24
Je trouve cette distinction creuse. Les deux autres types d’Églises peuvent revendiquer vouloir « louer Dieu en toutes choses ». Les fondamentalistes n’ont donc pas en vue l’idée de louer Dieu en toutes choses ? Au contraire, ce sont eux les champions pour faire le lien entre des comportements anodins (aller à la piscine) et le culte rendu à Dieu. De même pour les tenants de l’évangile social : ils sont les premiers à vouloir étendre le culte de Dieu à toutes choses. L’idée et la distinction ont l’air bonne, mais lorsqu’on essaie de vraiment saisir le concept, on s’aperçoit qu’il est en fait très fumeux, et les auteurs ne donnent pas plus d’explications que ce que j’ai déjà cité. Il faut voir si Yoder donne plus de détails.
Pour illustrer leurs propos, ils racontent une expérience : lors du bombardement de Benghazi en 1986, l’auteur a été pris dans une conversation où on lui a demandé si c’était moral ou pas de bombarder. Pacifiste convaincu, il a dit qu’il ne pourrait jamais soutenir un bombardement d’aucune sorte. Alors, qu’aurait-il fallu faire, lui demanda-t-on. Il répondit qu’il aurait fallu que l’Église Méthodiste Unie envoie 1000 missionnaires.
À mes yeux, ceci n’est pas une réponse confessante, c’est une réponse à côté de la plaque : la question était qu’est ce que le gouvernement devait faire de ses avions de chasses, pas qu’est ce que l’Église Méthodiste Unie devrait faire de ses missionnaires inexistants.
Chapitre 3 – Le Salut en tant qu’aventure
La vie chrétienne est une marche, qu’est ce que cela implique pour l’Église ?
L’Église existe aujourd’hui comme un étranger dans la cité, une colonie aventurière dans une société d’incroyance. […] La Bonne Nouvelle que nous explorons ici, est que le succès de l’incroyance et la faillite du libéralisme politique ont rendu possible le retour du Christianisme en tant que voyage aventureux. La vie dans une colonie n’est pas sans histoires. Elle est sujette à des attaques constantes et la sédition contre ses vertus les plus chéries, elle est toujours en danger de perdre ses jeunes, considérée comme une menace à la culture athée, qui au nom de la liberté et l’égalité subjugue tout le monde – la colonie chrétienne peut être vue par ses membres comme un défi.
Ibid, pp. 27-8
En conséquence, l’Église devrait être dynamique plus que statique, offensive plus que défensive, changeante plutôt que conservatrice :
Une armée réussit, non pas dans la guerre de tranchée mais à travers le mouvement, la pénétration, la tactique. Ainsi donc, parler de l’Église en tant que colonie, ne fait pas référence à la colonie comme endroit, position fortifiée, qu’elle soit théologique ou géographique. La colonie est un peuple en mouvement, comme les premiers disciples de Jésus, cherchant à toute haleine à suivre Jésus. C’est une aventure remplie d’inconnues, des argument internes sur le chemin à prendre, des conversations en chemin, la visite de lieux étranges, des adieux et des ajouts, beaucoup de regards en arrière et des réapprovisionnement.
Ibid, p.28
Ici, les auteurs se mélangent un peu dans la métaphore : leur colonie est devenue une caravane.
On the Road again
Hauerwas et Willimon exposent la nature narrative de la religion chrétienne, et comment le christianisme répond à l’absence de méta-récit moderne par son propre « grand récit » :
La Bible est fondamentalement une histoire du voyage d’un peuple avec Dieu. L’Écriture est un récit de l’existence humaine racontée par Dieu. Dans l’Écriture, nous voyons que Dieu prend les éléments séparés de nos vie en les rassemblant dans une histoire cohérente qui a une signification. Quand nous manquons d’un tel récit vrai et cohérent, la vie est perçue comme déconnectée, ad hoc. En cherchant à donner un sens à notre vie alors que nous manquons d’un récit cohérent, la vie est à peine plus qu’un pas à gauche, un pas à droite.
Ibid, p. 28
Cette citation me semble déjà bien centrée sur l’homme pour commencer, et oublier que le grand fil qui traverse la Bible n’est pas notre vie, mais celle de Jésus. La suite m’inquiète encore plus plus : le prologue de l’évangile de Jean n’a-t-il rien à dire de métaphysique sur l’incarnation ?!
Il est intéressant que les premiers chrétiens n’ont pas commencé avec des spéculations doctrinales sur la métaphysique de l’incarnation – c’est-à-dire une christologie abstraite des récits évangéliques. Ils ont commencé par des histoires de Jésus, dont la vie a rattrapé leurs vies. Ainsi donc, d’une façon plus sophistiquée et engageante, les auteurs des évangiles ont été capables de commencer à nous entraîner à situer nos vies dans sa vie.
Ibid, p. 28
Faire partie de l’Église signifie faire partie de l’histoire du salut, et nous engendrons nos enfants afin de leur raconter à leur tour l’histoire de l’Évangile, et qu’ils la vivent en leur temps, voici pour les auteurs.
Les vertus de l’aventure
Pour marcher le long de cette route il faut développer des vertus telles que le sens de notre mission (se souvenir de l’eschatologie chrétienne). Il faut aussi s’équiper d’une éthique de révolutionnaire : rigide, fidèle à un idéal.
L’éthique chrétienne, en tant que culture de ces vertus nécessaires pour nous garder dans notre périple, est l’éthique de la révolution. Les révolutionnaires, dont le but n’était rien de moins que la transformation de la société par la révolution, n’avaient que peu de patience avec les paresseux, et ils n’avaient aucun problème pour discipliner de telles personnes. La discipline qu’ils s’exigeaient à eux-même est un moyen de diriger les autres vers le vrai et le bien. N’ayant pas l’usage de telles vertus bourgeoises comme la tolérance, l’ouverture d’esprit et l’inclusivité (que les révolutionnaires savent être habituellement des vernis destinés à maintenir l’équilibre social en faveur des puissants plutôt que de les confronter et les changer). Les révolutionnaires valorisent l’honnêteté et la confrontation – aussi douloureuse qu’elles soient. L’enjeu est grand, et les tentations de contre-révolution sont trop séduisantes, la route est trop difficile pour accepter quoi que ce soit de moins qu’une communauté révolutionnaire. À celui qui est extérieur, et en particulier l’extérieur au pouvoir, l’éthique du révolutionnaire peut paraître dure, sans compromis et même absurde. Mais si on prend la vision du révolutionnaire, la vision ultime vers laquelle le révolutionnaire s’approche, l’éthique révolutionnaire a un sens. Elle est, dans son propre sécularisme, une éthique de l’aventure qui n’est pas sans parallèle avec l’éthique du chrétien.
Ibid, p.35
Je ne suis pas en désaccord complet avec cette citation, même si l’esthétique révolutionnaire n’est pas ma préférée.
Chapitre 4 – La vie dans la colonie : l’Église comme base de l’éthique
Les auteurs partent d’un appel de Falwell (Figure de la droite religieuse) à donner pour une œuvre d’accueil des femmes enceintes. Laissant de côté la question de l’avortement (qui est « peut-être » mauvais), ils disent que c’est une mauvaise méthode de d’abord élaborer une « position chrétienne » intellectuelle, puis de la proposer au gouvernement. Ils n’épargnent pas non plus les libéraux qui font la même chose, mais à gauche.
Falwell a raison dans le sens où l’éthique se pratique en Église. Tout le problème est de maintenir une éthique spécifique au christianisme plutôt que de christianiser une tradition culturelle (de droite ou de gauche).
Sur la base du sermon sur la montagne en Matthieu 5, les auteurs attaquent la « tentation minimaliste » : ne défendre que la justice et la paix et puis ça suffira. Contre cela, il rappelle les paroles de Jésus : il nous faut plus qu’évoquer de vagues valeurs, il faut la totalité du concept et de la pratique même, jusqu’au cœur ! Cela nécessite une communauté contre-culturelle pour vivre les paroles du sermon sur la Montagne.
Objection : Cela ne s’applique qu’à Jésus. Réponse : Ce n’est pas une distinction que l’on trouve dans le texte du sermon sur la montagne.
Objection : Cette éthique est surréaliste et non applicable (dixit Reinhold Niebuhr, Moral Men and Immoral Society). Réponse : Le sermon s’adresse à l’Église entière, au sens collectif.
Le but de l’éthique chrétienne ce n’est pas simplement le vivre ensemble : c’est la voie de Jésus Christ. Il faut développer une éthique communautaire. Il n’y a pas d’éthique individuelle, c’est-à-dire, élaborée par un individu utilisant sa raison dans son coin. Elle s’élabore collectivement, et ne peut être vécue qu’en communauté. Il faut donc utiliser le sermon sur la Montagne comme objet de désir collectif pour atteindre notre but. L’eschatologie chrétienne nous aide à désirer davantage ce but. Loin d’être un obstacle à l’engagement, elle est un carburant. Sans eschatologie, il n’y a plus que du légalisme et du moralisme,
Je suis plutôt en accord avec ceci, à la différence près que pour moi le sermon sur la Montagne n’est pas isolé, mais qu’il vient intensifier les 10 commandements. Il ne s’oppose pas à l’esprit de la Loi de Moïse, mais veut l’intensifier au contraire.
Citation de conclusion du chapitre : il faut abandonner l’évangile social :
Nous avons pu penser que Jésus est venu pour que les gentils deviennent plus gentils, que Jésus espérait de faire de César le démocrate quelqu’un de plus démocrate, de faire du monde un meilleur endroit pour le pauvre. Le Sermon cependant entre en collisions avec une telle pensée accomodationiste. Elle nous ramène à une toute nouvelle conception de ce que signifie vivre ensemble. Cette toute nouvelle conception est l’Église. Tout ce que nous avons entendu depuis le début est à saisir, demande à être rééxaminé, et d’en revenir au début. Le début, c’est cette colonie faite de ceux qui sont spéciaux, différents, étrangers et distincts uniquement par le fait qu’ils ont entendu Jésus dire : « Suis-moi », et ont rejoint le nouveau peuple, une colonie formée par l’invitation de Jésus et sa réponse positive.
Ibid, p.53
Les chapitres 5 à 7 illustrent davantage cet « église narrative » qu’ils proposent, et il y a de bonne remarques sur les pasteurs libéraux. D’après les auteurs, l’excès d’engagement social des pasteurs engendre des ministres épuisés et des assemblées sous tension. L’interprétation biblique doit redevenir la marque du pasteur. Contre le pasteur thérapeute qui engendre de l’épuisement et une vie décousue, il faut refaire du pasteur un conteur [storyteller].
Conclusion
J’approuve bien entendu que l’on abandonne l’évangile social, qui est une aberration monstrueuse. Mais son texte est bien trop ambigu pour que je réussisse ensuite à trouver son sens : quelle est sa définition de l’Église? Quels sont ses membres? Quels sont leurs devoirs ? Jusqu’où peuvent ils aller dans leurs activités civiles, ont-ils le droit de faire carrière dans des postes à responsabilités ? Il est beau de faire partie d’une grande histoire, mais l’histoire elle-même a une fin : laquelle? Hauerwas et Willimon sont en train de ressortir le sempiternel « ce n’est pas la destination qui compte, c’est le chemin », mais en refusant de systématiser une doctrine, ils peuvent tout aussi bien tourner en rond dans le désert… De manière générale, quand j’ai lu ce livre, à chaque fois que j’ai voulu en toute bonne volonté trouver quelque chose à m’approprier, je me suis heurté à l’ambiguïté fumeuse de leur discours. C’est du reste assez cohérent : ayant rejeté dès le chapitre 1 la doctrine pour se concentrer sur l’éthique (sans doctrine) nous en sommes rendus à « suivre nos pieds » intellectuellement.
Au risque de me répéter : ce livre doit être interprété comme une réaction à l’évangile social interne au libéralisme, et qui propose une nouvelle voie post-moderne axée sur l’église comme corps narratif. Si vous êtes intéressés par cette approche, alors ce livre est un incontournable et l’œuvre fondatrice de cette démarche. Si vous êtes dans une démarche confessante ou évangélique, il n’a que peu d’intérêt, à cause de sa trop grande ambiguïté et son rejet de la doctrine.
- plus grand organe œcuménique des États-Unis[↩]
- faisant le lien avec le monde porté sur une tortue des indiens[↩]
- tout comme quand on parle « d’athéisme pratique »[↩]
- A People in the World: Theological Interpretation,” in The Concept of the Believer’s Church, ed. James Leo Garrett, Jr. (Scottdale, Pa.: Herald Press,1969), pp. 252-83).[↩]
- Yoder est un anabaptiste, ça ne peut pas être notre sens de « confessant »[↩]





0 commentaires
Trackbacks/Pingbacks